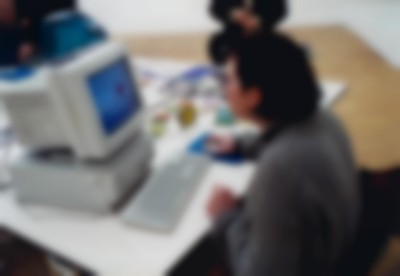Session 8: presentation
| Session | 8 (1997–1998) |
|---|---|
| Participants |
Charles Barachon |
| Direction |
Yves Aupetitallot |
| Session website | – |
| Coordination |
Véronique Terrier-Hermann |
| Tutoring |
Lionel Bovier |
| Educational team |
Catherine Quéloz |
| People met |
Paul Ardenne (art historian) |
| Travels |
Geneva |
Managers de l'immaturité
| Project |
Managers de l'immaturité |
|---|---|
| Presentation |
Curated by Dominique Gonzales-Foerster and organized in collaboration with three participants from Session 8 (Charles Barachon, Keren Detton and Reiko Setsuda), the exhibition brought together forty-one artists from the art schools in Lyon, Annecy, Grenoble, Saint-Étienne and Valence. |
| Format |
Exhibition |
| Date |
17 January – 7 February 1999 |
| Location |
Magasin–CNAC |
| With |
Zbigniew K. Adach |
Related archive
Pl@ytimes
| Project |
Pl@ytimes |
|---|---|
| Presentation | – |
| Format | – |
| Date | – |
| Location | – |
| With | – |
Related archive
Documents
Photographs
La pratique curatoriale : un domaine d'étude?
| Project |
La pratique curatoriale : un domaine d'étude? |
|---|---|
| Presentation | – |
| Format | – |
| Date | – |
| Location | – |
| With | – |
Interview with Keren Detton
Entretien avec Keren Detton
par Damien Airault
25.06.2018
Damien Airault : Tu es née en quelle année Keren ?
Keren Detton : En 1976 à Paris.
DA : Qu’est-ce que tu as fait avant de faire l’École du Magasin ?
KD : J’ai suivi la formation de premier cycle de l’École du Louvre avec une spécialité en art contemporain.
DA : Qui étaient les professeurs importants à l’époque ?
KD : Il s’agissait presque toujours de personnalités actives dans les musées. Il y avait pour l’art contemporain des figures marquantes comme Bernard Blistène qui partageait sa passion et son engagement, Didier Ottinger dont l’approche était plus historique, Christine Macel qui, par le biais d’invitations à différents acteurs de l’art, nous mettait le pied à l’étrier. Cette découverte de l’art contemporain était confortée par des visites régulières dans les musées et les galeries. Déjà là, nous étions sensibilisés à une histoire des expositions : les grandes manifestations comme la Documenta ou la Biennale de Venise, et les expositions en France qui permettaient d’approcher divers médiums : « L’Art au corps », « Poésure et Peinterie », « Passages de l’image », « Hors Limites »… Je me souviens aussi particulièrement des cours de Michel Poivert sur l’histoire de la photographie et de la modernité, et ceux de Zeev Gourarier, sur les arts et traditions populaires, qui nous poussaient à réviser nos canons. Mais l’ouverture vers les cultural et gender studies s’est faite plus tard et en particulier à l’École du Magasin.
DA : Comment est-ce que tu as connu l’École?
KD : J’ai un souvenir très précis du flyer qui présentait l’École du Magasin et de son graphisme très sobre… mais aucun souvenir précis d’où et comment je suis tombée dessus.
DA : Qu’est-ce qui fait que tu vas à l’École du Magasin ?
KD : Après la formation en histoire de l’art à l’École du Louvre, je voulais vivre des expériences de terrain. Je craignais que le parcours balisé menant au statut de « conservateur » du patrimoine m’éloigne de mon objectif premier, à savoir collaborer avec des artistes vivants. Je voulais être d’emblée plongée dans une formation professionnelle à la fois théorique et pratique.
DA : À l’époque, est-ce que tu étais au courant des problématiques du commissariat d’exposition indépendant qui commençait à apparaître depuis trois-quatre ans ?
KD : Je suis entrée à l’École du Magasin en ayant conscience que de plus en plus d’institutions faisaient appel à des curateurs invités. Pour moi, cette formation devait apporter des compétences techniques mais aussi compléter un bagage culturel permettant d’articuler des formes polysémiques et critiques. L’exposition qui a sans doute marqué mon orientation professionnelle est un véritable ovni curatorial : L’Hiver de l’amour au Musée d’art moderne de la ville de Paris en 1994 organisée par Elein Fleiss, Dominique Gonzalez-Foerster, Bernard Joisten, Jean-Luc Vilmouth et Olivier Zahm. Dans un esprit assez proche, je me souviens de l’effet qu’avait produite sur moi l’exposition Dominique Gonzales-Foerster, Pierre Huyghe, Philippe Parreno (1999). Dans cette exposition, les dimensions narratives, spéculatives et désynchronisées invitaient à prendre conscience de nos corps et de nos regards de manière tout à fait inédite. Ces expositions, auxquelles prenaient part les artistes en tant que commissaires, ont marqué mon intérêt pour la fonction d’auteur et de co-auteur.
DA : Tu voyais l’École comme quelque chose d’assez prestigieux et international déjà à l’époque ?
KD : Les expositions que j’ai citées impliquaient des artistes venant de l’école d’art de Grenoble. Cette ville avait pour moi, déjà, cette aura-là. La formation curatoriale était, elle aussi, réputée et son concours était international. Aussi, je me suis sentie particulièrement privilégiée au moment de la rejoindre.
DA : Donc tu faisais partie de la Session 8 de 1998 à 1999. Tu te souviens comment s’est passé ton entretien, ou de ce qu’on t’a demandé de produire pour rentrer, qui est-ce qu’il y avait dans le jury, etc. ?
KD : Le dossier que j’ai présenté devait comprendre un projet fictif d’exposition. J’avais choisi de travailler sur une exposition mêlant art et chorégraphie. À l’époque, la transdisciplinarité était très en vogue, mais il n’y avait quasiment rien sur la danse, et je me souviens avoir passé beaucoup de temps à me documenter.
DA : Qui y avait-il avec toi dans ton année ?
KD : Reiko Setsuda, Charles Barachon, Nikola Jankovic mais qui a abandonné en cours de route, Karine Vonna, Asli Telli, et puis il y avait Doris Baschofen.
DA : Et à la coordination ?
KD : L’École était en train de se restructurer. C’est Alice Vergara qui nous a reçu.e.s puis Véronique Terrier-Hermann est venue afin d’assurer une coordination continue. Elle faisait le lien avec Catherine Quéloz, dont le rôle était de consolider un corpus de textes théoriques sur le commissariat d’exposition, élargi aux grandes questions sociales et politiques (critique institutionnelle, féminisme, post-colonialisme…). Vers la fin de l’année, Lionel Bovier est venu compléter les enseignements. Il était très jeune mais partageait déjà volontiers son expérience sur des formats particuliers d’exposition : la peinture hyperréaliste accrochée sur des parois réfléchissantes en vinyle noir, l’art optique et abstrait installé autour d’une rampe de skate.
DA : C’est l’exposition Oops 1 ?
KD : C’est ça.
DA : Liliane et Catherine ont une façon particulière de construire un séminaire, avec une bibliographie conjointe. Je trouve qu’elles étaient très en avance : beaucoup de texte en anglais, beaucoup d’intellectuels new-yorkais peu connus… Qu’est-ce que vous lisiez ?
KD : À mon époque, il n’y avait que Catherine qui intervenait. Elle nous communiquait beaucoup de textes, effectivement : Craig Owens, Sherry Levine, Will Doherty, mais aussi Michel Foucault, Roland Barthes…
DA : Vous aviez des lectures sur des problématiques plus sociales comme le sida ou le féminisme ?
KD : Sur le féminisme, oui, et sur tout ce qui construit les normes, comme le « white cube ». On a beaucoup regardé Group Material et leur manière de créer autour de sujets sociaux et ancrés historiquement. C’était très inspirant.
DA : De quelle manière votre emploi du temps était-il géré ? Vous aviez des horaires obligés ?
KD : Le cursus proposé donnait l’impression de se chercher encore. Des modes d’organisation nouveaux étaient testés entre le centre d’art et l’École. Il y avait des temps fixes dans la semaine pour des cours. Ceux consacrés à l’administration des projets et à la gestion étaient encadrés par l’administratrice du Magasin qui partageait avec nous ses outils de travail. Il y avait aussi des cours d’anglais appliqué à l’art contemporain. Le reste du temps nous faisions des ateliers de lecture et on nous incitait aussi à écrire, analyser et commenter des œuvres ou des expositions.
DA : Et les rencontres que vous faisiez c’était à votre initiative ?
KD : C’était partagé, nos initiatives étaient encouragées. Certaines personnes venaient régulièrement d’autres venaient une journée présenter leurs recherches ou leurs parcours et nous rencontraient ensuite individuellement.
DA : Comme qui ?
KD : Au Magasin, j’ai pu rencontrer Julie Ault du collectif Group Material, Dominique Gonzalez-Foerster (qui elle-même avait suivi la formation du Magasin), Jean-Charles Massera qui venait de publier Amour, gloire et CAC40, Franck Gautherot du Consortium, Zeigam Azizov artiste et philosophe, Paul Ardenne qui préparait son exposition sur les « Micropolitiques » avec Christine Macel, Hans-Ulrich Obrist… Une des rencontres qui m’a le plus marquée était Stéphanie Moisdon venue nous parler de son exposition pour le CAPC de Bordeaux : Présumés innocents. En abordant l’enfance sans tabous, elle donnait à réfléchir sur la liberté d’expression et la responsabilité d’une curatrice. Je l’ai retrouvée, par la suite, alors que je cherchais du travail. Elle m’a ainsi recrutée comme assistante pour la préparation de deux expositions : Genesis Sculpture (Domaine Pommery, Reims) et Before the End (Le Consortium, Dijon).
DA : Vous avez peut-être vu Christophe Chérix, Christian Bernard ?
KD : Nous étions allés les voir à Genève. Christian Bernard au MAMCO nous avait conté la genèse de ce musée et son engagement au long cours avec différents artistes : Sarkis et son atelier à demeure, la collection Yoon Ya et Paul Devautour, et l’enchevêtrement des temporalités d’expositions. Christophe Chérix, au cabinet d’art graphique, présentait les estampes de la collection, en particulier In the Realm of the Carceral de Robert Morris, œuvre que j’ai par la suite exposée au centre d’art Le Quartier à Quimper. Nous rencontrions aussi des artistes : le collectif KLAT qui s’occupait de l’espace Forde à Genève, Seamus Farrell à Art3 Valences et Marie Denis alors en résidence dans un petit village en Rhône-Alpes. Plus loin, nous sommes allés à la découverte de « Manifesta » dont c’était la deuxième édition au Luxembourg et avons rencontré certains des artistes et organisateurs.
DA : Quels étaient vos liens avec l’école d’art de Grenoble ?
KD : Cette école d’art avait une certaine reconnaissance liée aux artistes qui en étaient issu.e.s comme Pierre Joseph ou Philippe Parreno. Pour la première fois, un enseignant, Ange Leccia, avait été désigné pour assurer un lien entre l’école d’art et l’École du Magasin. Les rencontres étaient fréquentes avec les étudiants et nous avions notamment accès à leur espace de documentation. C’est à cette époque que j’ai rencontré Julien Prévieux ainsi que Christelle Lheureux.
DA : Il y avait Gianni Motti à Grenoble déjà à ce moment ?
KD : En effet, c’était un enseignant très charismatique mais il était peu présent autour de nous.
DA : On vous demande de faire des projets : vous en avez fait combien ? Toi, tu apparais dans deux publications, une qui est celle de votre projet, Playtimes, et une autre qui est plus étrange qui n’est pas signée par l’École mais dans laquelle ton nom apparaît, Les Managers de l’immaturité.
Playtimes, s’est construit comment ? Qui en a eu l’idée ? On vous a donné une salle et on vous a dit « remplissez-là » ?
KD : Notre formation devait aboutir à une exposition en fin d’année. Pour la première fois, l’École avait souhaité que nous trouvions nous même un lieu d’exposition ce qui était très bizarre… vers qui se tourner : une association, une municipalité, un autre centre d’art ? Comment présenter un projet encore inexistant et quels termes négocier ?
On a donc tourné en rond pendant quelques temps, non sans tensions avec l’administration, jusqu’à ce que, finalement, un accord soit trouvé pour que l’école d’art accueille notre exposition.
C’était quand même essentiel de pouvoir se projeter dans un espace. Nous savions que nous pouvions emprunter des œuvres au FRAC mais nous étions plus intéressé.e.s par des contacts directs avec des artistes. Pour le sujet nous avions carte blanche, ce qui n’était pas évident étant donné la diversité des personnalité réunies dans ce programme. Ça a été assez laborieux. Finalement, deux groupes se sont constitués, l’un autour du projet Playtimes à l’école d’art et un autre a monté un projet au CAB à la Bastille (qui n’avait pas encore ce nom, je crois).
DA : Pour Playtimes, vous vous êtes mis d’accord sur une liste d’artistes ? Ou chacun apportait des noms et il y avait un système de veto, de goût personnel, ou c’était collégial, consensuel ?
KD : C’était difficile de se mettre d’accord néanmoins la liste des artistes a été validée ensemble en prenant soin d’inclure différents médiums, y compris la peinture avec Miltos Manetas. Par ailleurs, chacun.e a pris en charge un aspect spécifique du projet et qui sortait du cadre strictement artistique. Reiko Setsuda avait compilé une documentation sur le phénomène des otakus au Japon, Karine Vonna avait porté les pédagogies expérimentales de François Deck dans l’exposition, Charles Barrachon avait contacté Pierre Joseph pour que nous puissions présenter son CV. J’étais, pour ma part, engagée dans une collaboration avec Éric Zimmerman, concepteur de jeux, pour imaginer des dispositifs de jeu à l’échelle de l’espace d’exposition mais aussi adaptés à l’édition.
DA : Ça marchait bien ? Les gens participaient ? Sur les vues d’expositions, on voit des ordinateurs, des fauteuils gonflables…
KD : Oui, la circulation entre les œuvres et artefacts était relativement fluide. Nous avions pris le parti d’utiliser toute la hauteur des murs en apposant des citations. Je me souviens aussi des discussions sur la hauteur d’accrochage des tableaux qui tranchait avec les habitudes. Les fauteuils gonflables, à l’esthétique marquée, permettaient de visionner confortablement les vidéos.
DA : Et pour cette exposition, on vous a donné un budget à l’avance ou vous proposiez des lignes de dépense et on vous disait oui ou non ?
KD : Nous gérions le budget mais n’avions pas en main tous les éléments. Je me souviens que le premier projet que nous avions monté intégralement était un symposium sur le curating. On avait invité Teresa Gleadow du Royal College of Art de Londres, Dorothée Richter de Zürich, Ramon Tio Bellido… Cette expérience nous avait vraiment mis le pied à l’étrier.
DA : Tu te souviens où s’est passé ce symposium ?
KD : Dans l’espace de conférence au fond de la « Rue » du Magasin.
DA : Et l’autre projet, Les Managers de l’immaturité, qu’est-ce que c’était ?
KD : L’école d’art a confié à Dominque Gonzalez-Foester le commissariat de l’exposition des diplômés qui s’est déroulée dans le centre d’art du Magasin. Dominique a construit un système réflexif et, de manière ironique, a proposé cet intitulé provocateur. Le projet était constitué de trois zones : une zone où les artistes étaient autogérés ; une zone où ils étaient accompagnés ; et une zone où ils répondaient au curateur-auteur et ils n’avaient pas leur mot à dire.
DA : C’est génial ! On n’y comprend rien du tout en fait quand on lit le catalogue…
KD : Puis elle a proposé à trois personnes de l’École du Magasin de prendre un rôle curatorial. J’ai choisi la deuxième zone, c’est-à-dire l’accompagnement au consensus.
DA : Et donc ça s’est passé en même temps que Playtimes ?
KD : Je ne me souviens plus… En tout cas, j’ai apprécié cette mise en condition des Managers de l’immaturité. C’était une expérience qui permettait un échange privilégié avec les diplômés tout en mettant en perspective les jeux de pouvoir à l’œuvre.
DA : Ce lien avec les artistes et la possibilité de faire une exposition de moyenne taille et de vraiment suivre les artistes, disparaît un petit peu dans les années qui suivent, à cause du manque de lieu. Donc on se retrouve beaucoup dans des archives et dans des choses qui sont très dématérialisées. Du coup, les artistes et le lien à l’atelier ou à l’œuvre disparaît un petit peu. C’est une chose dont on s’est rendu compte dans nos recherches. Et comment se passait le lien avec le centre d’art ?
KD : C’était assez dysfonctionnel. Tu vois comment est un centre d’art et tu connais le lieu… l’équipe était très bienveillante mais souvent « dans le jus » donc assez peu d’échanges… En particulier, on ne voyait pas bien comment l’équipe des publics travaillait et la médiation est un sujet auquel on a peu touché. En même temps, nous étions au cœur de la machine et dès que des artistes venaient nous les rencontrions.
DA : Toi, tu as habité à Grenoble pendant cette période.
KD : Oui.
DA : Vous aviez une bourse, des per diem ? Comment tu as survécu à cette période ?
KD : C’était sur nos fonds propres. Je crois que pour les étrangers c’était peut-être différent. Pour moi, c’était comme étudier à l’université… c’est rare d’être boursier.
DA : Et à la sortie de l’École, qu’est-ce que tu as fait ?
KD : J’ai privilégié des expériences professionnelles dans des structures très différentes et à l’international. Après un stage au Consortium à Dijon, je suis allée à la Cubitt Gallery de Londres, un artist-run-space dont le programme était tenu par Stephan Kalmar, puis j’ai poursuivi à Jérusalem en combinant un stage au Musée d’Israël avec Sarit Shapira et en suivant les rencontres avec des étudiants de fin d’année de l’école d’art de Bezalel.
DA : Qu’est-ce que tu penses que l’École du Magasin t’a apporté du point de vue de ta carrière et, deuxième question, différente : pour te construire ?
KD : Pour moi, la formation du Magasin a constitué un véritable tremplin professionnel. Mais je voudrais signaler les difficultés liées au manque de cadrage au départ. La plupart des participants avaient des parcours professionnels déjà établis. Il y avait quand même un aspect assez scolaire, mais pas complètement assumé, c’est ce qui était difficile à supporter. Il n’était pas non plus évident de composer avec des personnalités très fortes.
DA : Pour les années où toi tu y as participé, les critiques qu’on entend sont la plupart du temps exactement l’inverse. De Paris, l’École du Magasin était un lieu où les élèves étaient livrés à eux-mêmes. C’était un truc autogéré. Ils n’apprenaient rien, ils ne savaient rien faire à la sortie.
KD : C’est en réaction à ces critiques que l’École cherchait justement à se réinventer, mais de manière encore très maladroite. Si tu veux, pour moi, la chance c’est que je sortais de l’École du Louvre. L’École du Magasin cherchait des candidats déjà dans le champ professionnel mais en réalité je trouve que c’était plus adapté à des juniors qui, comme moi, étaient encore dans la découverte et qui pouvaient profiter d’une ouverture professionnelle, de références théoriques et de contacts.
- Organisée par Lionel Bovier, l’exposition Oops est présentée au Magasin–Centre national d’art contemporain de Grenobl du 6 juin au 6 septembre 1998. ↩