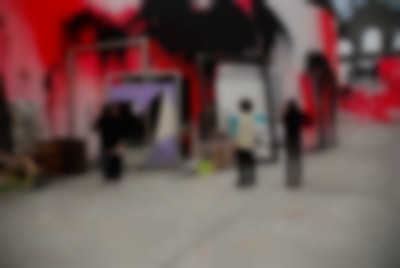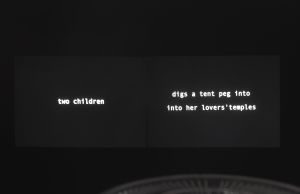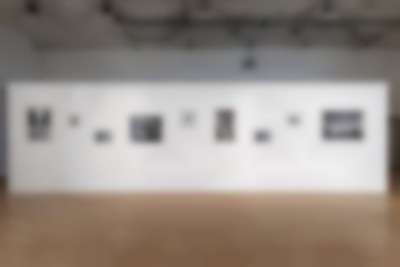Session 22: presentation
| Session | 22 (2012–2013) |
|---|---|
| Participants |
Michela Alessandrini |
| Direction |
Yves Aupetitallot |
| Session website | |
| Coordination |
Lore Gablier |
| Tutoring |
Caroline Soyez-Petithomme |
| Educational team | – |
| People met |
Pierre Bal-Blanc |
| Travels | – |
I lie to them. Based on a true story
| Project |
I lie to them. Based on a true story |
|---|---|
| Presentation |
The exhibition “I Lie to Them.” Based on a True Story explores the effectiveness of fiction in re-telling, re- representing and re-enacting traumatic experiences and unofficial histories. The artists blur the boundaries between real and fake, employing strategies of manipulation to create new narratives appropriated from archives, news images or war witness accounts; while questioning both the medium and the source’s authenticity. But how do we know what is true if the narration of the story changes every time? The act of retelling presupposes different degrees of comprehension that ‘occupy’ and control the flow of (hi)story by taking a stand in its construction and production of meaning. As for the gathered artworks, are they simply some other subjective versions added to the plethora of stories used by the authorities or the media? Can their inherent creation processes recall the lies, the alleged truth to which we are exposed almost daily? |
| Format |
Exhibition |
| Date |
9 June – 1 September 2013 |
| Location |
Auditorium, Magasin-CNAC |
| With |
Bani Abidi et Omer Fast Graphic design and webiste: Florian Eberhardt, Olivier Raimbaud, Thibaut Vandebuerie et Benjamin Vigliotta |
Interview with Michela Alessandrini
Entretien avec Michela Alessandrini
par Asli Seven
Asli Seven : Tu as fait partie de la Session 22. Parle-moi de ton expérience.
Michela Alessandrini : Je pense que notre expérience de l’École a été pour toutes très émotionnelle et nous a travaillé sur un niveau personnel. Quelque part, il me semble qu’il y a eu un échec du collectif : on avait des origines, des préoccupations et des axes de recherche différents. Au lieu d’utiliser cela comme une force pour le groupe, des dynamiques de micro-pouvoir interne se sont installées, qui nous ont séparées plus qu’unies. On n’était peut-être pas assez matures pour voir notre potentiel, ou pour l’organiser. Du coup, deux, trois sous-groupes se sont formés. Katia [Ekateriana Shcherbakova] et moi nous sommes rapprochées. Ça m’a aussi permis de comprendre la nécessité, dans une aventure comme celle de l’École du Magasin, d’avoir un partenaire. Avoir Katia tous les jours qui me soutenait et que je soutenais a été un soulagement du début à la fin. C’est d’ailleurs avec elle qu’on a développé une collaboration qui a commencé au Magasin et qui a continué dans le temps.
Mais peut-être devrais-je parler d’abord de ce qui m’est resté de notre projet d’exposition collectif. C’était un projet peu ambitieux, que je n’assume pas trop, mais qui est le résultat d’un compromis. Si on veut, la spontanéité et la créativité de ce projet ont été un peu écrasées par la nécessité de trouver un sujet et des solutions qui conviennent à tout le monde. On était toutes très différentes, et la seule chose sur laquelle on était d’accord, c’était qu’on voulait faire une exposition. Le site Internet c’est quelque chose qui s’est ajouté. Pour le réaliser, on a travaillé avec un groupe d’étudiants en design graphique de l’école des beaux-arts de Lyon, ce qui nous avait été suggéré par Lore [Gablier] qui était notre coordinatrice. Notre tutrice était Caroline Soyez-Petithomme mais elle n’est arrivée qu’en janvier. Pour nous c’était un peu trop tard, de plus ça a emmené de la confusion quant aux rôles respectifs de Lore et Caroline. Yves [Aupetitallot] était plutôt absent sauf quand on le sollicitait pour des réunions. À un moment, on avait proposé des réunions hebdomadaires pour discuter des problèmes qu’on rencontrait dans la réalisation de l’exposition. J’avais beaucoup de sympathie pour lui mais c’est vrai qu’il ne semblait pas être très intéressé par l’École. Je crois que son potentiel lui échappait.
Notre projet s’est donc développé principalement à partir de la théorie. Je regardais nos archives tout à l’heure et je me suis rendue compte du nombre de textes qu’on a lus et produits. Ce qui était assez problématique pour certaines. Par exemple, Laurie [Chappis-Peron] était artiste et elle n’était pas très intéressée par des questionnements plutôt théoriques ou académiques. Les autres avaient un bagage théorique et d’histoire de l’art comme Carmen [Stolfi] ou de management culturel comme Katia et Kanika [Anand].
Le programme était divisé en deux parties. Les trois premiers mois étaient dédiés à la théorie, et à la fin en décembre, il y avait une évaluation avec Yves et Lore. La seconde partie du programme était dédiée à la production mais on a commencé à vraiment travailler sur l’exposition de façon concrète à partir de mars, pas avant. Ça a été vraiment très dense théoriquement. On avait commencé à faire des recherches sur des sujets très variés. Chacune avait développé son thème et puis finalement on a fait tout autre chose. Les thèmes étaient : « collective history » ; « storytelling » ; « superhero/Anymous/masque » ; « trauma » ; « undesirability of truth ». C’étaient comme des noyaux de recherche qu’on avait développés au début de l’année. Par exemple, je me suis occupée de la question du collectif car pour moi c’était vraiment important de comprendre comment agir dans un collectif curatorial. Car même si on ne s’était pas choisies, on était amenées à se confronter à cette question de façon quotidienne. C’était intéressant de comprendre ça en poussant la recherche dans l’art et dans les collectifs d’artistes. J’avais fait toute une série d’entretiens avec des collectifs d’artistes.
Puis finalement, ce qu’on a fait c’était un projet d’exposition qu’on a appelé Je leur mens. D’après une histoire vraie. Le vernissage était le 8 juin. On avait à disposition la salle de l’auditorium parce que dans les galeries et dans La Rue il y avait l’exposition de Pietro Roccasalva, qui était curatée par Yves et Bruna Roccasalva – la sœur de Pietro et également co-directrice de Peephole à Milan. Ils avaient donc occupé tout l’espace principal et toute l’équipe était mobilisée pour cette exposition. Nous, on n’avait presque rien. On a dû tout faire, même au niveau du montage. On a dû construire beaucoup de faux murs et on a payé une grosse somme pour les monteurs. Il n’y avait pas de personnel et on n’a pas compris comment notre budget a été utilisé. Bref : c’était la petite exposition des étudiantes, mais malgré que je n’ai aucune affection pour cette exposition, je sais que la réflexion qui nous a amenées à la monter était solide et méritait une meilleure visibilité.Dans l’exposition il y avait des œuvres de Critical Art Ensemble, Bani Abidi et Omer Fast, Agnès Geoffray, Riikka Kuoppala, Mladen Miljanovic, David Ter-Oganyan. L’exposition portait sur la manière dont la terreur est utilisée politiquement dans la représentation – qu’elle soit artistique ou politico-sociale. Une question très actuelle, mais loin de ce que la plupart du groupe aurait pu accueillir, défendre, sentir. Une opération purement conceptuelle, avec peu de contacts avec les artistes finalement, et surtout trop tard. La théorie et la recherche nous avait amené aux artistes et pas l’inverse, et cela est très loin de ce que je défends aujourd’hui comme curatrice. Cela ne m’intéresse pas.
Imaginons une exposition sur la terreur conçue par des curatrices internationales à Grenoble : je n’arrive pas à penser à quelque chose de plus abstrait. L’art était un outil pour porter notre discours, je trouve cela foncièrement mauvais… l’École du Magasin n’était pas la Goldsmith, mais il y avait une tendance à s’y rapprocher dans cette session, qui me dérange toujours.
Notre vernissage a donc eu lieu le même jour que celui de l’exposition de Pietro Roccasalva. Il y avait des journalistes, on a fait des tours guidés. Le même jour, Katia et moi on s’est partagé entre l’espace du Magasin et celui de la Conciergerie du site Bouchayer-Viallet. Cette conciergerie était à l’état de friche à ce moment-là – personne ne l’avait jamais utilisée. On est donc allé voir la Mairie de Grenoble pour les convaincre de nous donner les clés. Yves s’est engagé en écrivant une lettre, mais c’était aussi dans la perspective d’utiliser ce site après comme une extension du Magasin – ce qui a été le cas comme tu le sais. On a donc obtenu l’accès à la Conciergerie. C’est un très bon souvenir, la concrétisation de notre projet avec l’école des beaux-arts, une exposition avec des amis artistes avec qui on partageait notre quotidien, l’après-École. Les verres, les discussions artistiques, l’amour. Cette vie parallèle m’a gardé proche de ma vérité, pendant l’année à Grenoble. C’était fondamental de faire autre chose, de sortir de la théorie, de rentrer dans la vie. Connaître des artistes, parler avec eux, les inviter à exposer leur travail… L’expérience avec les autres filles de la session avait été tellement difficile et émotionnelle, et d’un autre côté l’expérience à Grenoble a été très heureuse…
Il faut savoir qu’à ce moment-là il n’y avait aucun partenariat prévu entre l’École du Magasin et l’école des beaux-arts. Katia et moi, on trouvait ça dommage. Donc on est allées les voir et on a parlé avec eux. On a rencontré trois artistes avec qui on est devenus amis. Et on les a invités à produire et présenter des œuvres à la Conciergerie. L’exposition s’appelait This Is the Place et a ouvert le même jour que les autres expositions. On était très contentes.
Dans l’exposition, il y avait François Roux, Thomas Braize et André Guiboux. On était aussi devenues très proches du groupe OUI[ ^Géré par l’association AAA, OUI était centre d’art contemporain dédié à la jeune création et à la prospection tous azimuts qui a existé à Grenoble entre 2007 et 2012.]. On était aussi amis avec Camille Laurelli, Alexandra David. À partir de là, Katia et moi on a aussi créé d’autre expériences : par exemple, un journal qui s’appelait Cul-de-sac qui réunissait des entretiens avec ces artistes rencontrés pendant la période de Grenoble.
AS : Cette publication dont tu parles, elle était développée avec les membres de OUI ?
MA : Non, pas du tout, c’était Katia et moi. Et il y avait des personnes de OUI qui avaient été interviewées. Il y avait aussi d’autres artistes comme Société Réaliste que j’avais contactés pour parler de cette question du collectif.
AS : J’ai une question qui me semble importante : Comment qualifierais-tu ces projets que tu as développés avec Katia ? S’agissait-il d’une fuite en dehors de l’institution ? Est-ce que c’était cautionné par l’institution ? Quel était le degré d’inclusion dans l’institution ?
MA : Yves Aupetitallot nous a un peu soutenu au début en envoyant un courrier à la Ville de Grenoble, comme je disais. Mais l’institution n’était pas très engagée, même si Yves nous avait aussi suggéré de faire le vernissage le même jour pour profiter du passage des gens et des journalistes. Le projet à la Conciergerie était complètement indépendant, tout comme Cul-de-Sac. Il s’agissait pour nous de « mapper » le territoire de Grenoble qu’aucune d’entre nous ne connaissait, et donc au lieu de rester enfermées à l’École, on s’est investies auprès des artistes. C’était étonnant comment les autres filles de la session n’avaient aucune envie d’aller voir ce qui se faisait dans la ville. Alors que pour nous c’était vital de sortir de cette boîte dans laquelle on était enfermées à réfléchir à des concepts théoriques. Je caricature mais je ne néglige pas l’impact d’une telle expérience sur ma sensibilité de l’époque, sur ma confiance, sur ma direction et ma formation en tant que curatrice. J’ai une approche plus sensuelle et je viens d’un milieu rural du sud de l’Italie, ce que je revendique. Une fois, notre tutrice m’a dit que, comme je n’avais pas un PhD sur la « représentation », je ne pouvais pas parler de « re-représentation » dans le texte curatorial que je proposais. Ceci était extrêmement frustrant et castrateur, j’aurais voulu qu’on me laisse être moi-même au sein de cette expérience et proposer des concepts, des idées. Bref, tu vois comme c’était cathartique ? Des fois et avec un peu de regret, je me dis que j’ai choisi de faire un doctorat aussi pour prouver aux gens comme elle, qui ont encore besoin de voir tes titres pour te laisser parler, que j’avais des choses à dire. C’est tellement obsolète et vieux monde de penser ainsi.
Puis je crois qu’on n’avait pas choisi l’École du Magasin pour ça. On l’avait choisie pour son histoire, pour son approche avant-gardiste, alternative, accessible, inclusive. J’ai néanmoins gardé une bonne curiosité tout au long de l’aventure, et j’ai certainement pu me nourrir de bonnes références.Je me rappelle être arrivée à Grenoble bien avant le reste du groupe parce que je voulais prendre le temps de m’installer. En début d’année, on était invitées se présenter aux autres et pour moi, c’était assez difficile de parler de ce que j’avais fait avant. J’ai donc plutôt décidé de présenter un peu l’évolution du paysage de Grenoble telle que je l’avais perçue au cours des quinze jours précédents. À chaque arrêt du tram en direction de la Villeneuve, j’avais pris une photo du nom de l’arrêt et du paysage environnant. C’était impressionnant pour moi de voir comment le paysage changeait, entre la banlieue et le centre-ville. Dès le départ, j’étais plus intéressée par découvrir le territoire que la théorie, avec une naïveté que je défends. Dans une école, on devrait avoir le droit à la naïveté, je crois.
AS : Il y a des choses que tu as dites qui sont importantes pour moi. Tu dis que le groupe était assez versé sur la théorie et j’aimerais savoir si c’était votre décision ou s’il s’agissait du programme. D’où est venu ce choix ?
MA : Comme je l’ai dit, l’École nous avait été présentée ainsi : trois mois de théorie et le reste du temps serait consacré à la production. Lore insistait beaucoup sur ça, mais je pense que c’était raisonné de sa part et elle nous donnait des références qui étaient vraiment de grande qualité. Après, Caroline sortait de la Goldsmith et avait vraiment une approche trop scolaire pour nous. On s’est retrouvées à faire des exercices d’editing ou à écrire des textes en imaginant la fortune critique de notre exposition, en faisant un parcours à rebours sur d’autres expositions qui s’en rapprocheraient plus ou moins. Je pense que les paramètres qui ont produit un manque d’équilibre entre la théorie et la pratique étaient déjà là, mais cela venait aussi du profile de notre groupe. À part Laurie, les cinq autres personnes venaient du milieu académique.
AS : S’agissait-il plutôt d’une théorie de l’exposition – de l’histoire des expositions qui serait professionnellement curatoriale –, et non, comme ça a pu être le cas par le passé, axée sur les études culturelles ou la théorie critique ?
MA : Pas du tout. On ne se posait pas du tout la question de l’histoire des expositions. C’était très axé sur les études critiques et les études culturelles. À un moment, on a voulu inviter Žižek à l’École car il s’était beaucoup confronté à des questions qui nous interpelaient. Le seul contact qu’on avait avec l’histoire des expositions c’était à travers nos invités, par exemple Lorenzo Benedetti, Andrea Villiani, Giovanni Carmine et Nataša Ilić. Ah, et aussi Pierre Bal-Blanc, mais il n’était venu qu’une journée comme Lorenzo Benedetti. Alors que les autres étaient restés trois jours.
AS : Est-ce que vous avez pu décider qui inviter parmi ces gens ?
MA : Non, mais Lore nous avait dit qu’on pouvait proposer des invités. Et effectivement on aurait pu mais on ne l’a pas fait. On n’était jamais sûres. Il y a eu quelques propositions : Slavoj Žižek, Yves Citton. Et puis honnêtement, on n’a jamais eu l’impression qu’on pouvait décider de notre budget. Le seul voyage qu’on a fait c’était à Paris pendant la semaine de la FIAC. On est allées voir quelques institutions ; on a rencontré des gens notamment au Pavillon du Palais de Tokyo et au CAC Brétigny.
AS : C’était un voyage programmé par Lore ?
MA : Oui, Lore était coordinatrice. Et Caroline était tutrice. Elle était censée nous apporter des références théoriques mais elle est arrivée trop tard. Le groupe était déjà constitué et les références déjà figées. Quand elle est arrivée, elle a voulu nous ramener à la théorie et ça nous a un peu coincées. Par contre, en termes de déplacements, je me rappelle d’un voyage très beau, qui a duré une demi-journée, quand Katia et moi sommes allées chercher l’artiste David Ter-Oganyan à l’aéroport de Genève, la veille du vernissage, avec la voiture du Magasin. Et si tu veux, le voyage qui m’a le plus appris c’est celui-là. Parce que le voyage à Paris, franchement… On se sentait un peu obligées de poser des questions à des gens qu’on n’avait pas choisis de rencontrer. Et c’était trop tôt pour nous, on était en octobre. On n’était pas encore un groupe, on ne savait pas de quoi parler. On a eu l’impression que l’âge d’or du Magasin était loin derrière nous et que l’École avait besoin d’être reprise en main par l’institution. À ce moment-là, l’École était très en retrait du centre d’art, une bulle dans l’institution. C’était évident qu’il fallait la repenser. Ce qui est arrivé après, mais pas de la bonne façon…
AS : Cette impression que tu as d’un âge d’or passé, c’est une impression que tu as eu en arrivant sur place ou est-ce que tu l’avais déjà avant même de candidater ?
MA : Non, c’est une impression que j’ai eue en arrivant sur place en observant comment ça fonctionnait, et surtout après. En France, beaucoup de gens connaissent l’École, mais quand je demandais à des gens ailleurs en Europe, ils n’avaient aucune idée de son. Quand je leur disais qu’il s’agissait du premier programme de formation curatorial en Europe, ils répondaient qu’ils pensaient que c’était De Appel. Je me rappelle avoir lu cet article par Andrea Bellini [ ^Andrea Bellini, « Curatorial Schools », in Flash Art, 21 décembre 2016. Accessible en ligne : https://flash—-art.com/article/curatorial-schools/ ] dans lequel il faisait la liste des écoles curatoriales et de leur histoire. Je venais juste de finir mon mémoire sur le Mac/Val de Vitry-sur-Seine et l’engagement anthropologique/urbain que l’institution peut avoir. La question des expositions était une question sur laquelle je me penchais depuis deux ans. Juste avant l’École, j’avais fait une exposition avec une artiste à Budapest et je m’étais dit que ce serait bien de poursuivre dans cette direction. J’ai donc postulé car l’École du Magasin et la Konstfack à Stockholm étaient les seuls programmes gratuits. Et j’ai été prise au Magasin. Je ne connaissais personne qui y avait participé. Par contre, j’avais contacté Corrado Salzano qui avait participé juste avant à la Session 21. Mes attentes vis-à-vis l’École du Magasin… j’ai l’impression que l’École était au début principalement porté sur la pratique : le travail sur le tas, les étudiants sur le terrain… Ensuite, il y a eu une autre phase, marquée par cette impulsion théorique – et Liliane [Schneiter] et Catherine [Quéloz] disent qu’elle était déjà présente quelques années avant qu’elles arrivent. Et je me dis que quand moi j’arrive en 2012¬, on est dans un moment marqué par une professionnalisation. C’est à ce moment-là que le rapprochement avec l’école des beaux-arts commence : le commissaire d’exposition c’est un métier et est-ce qu’on peut donc aussi devenir une école qui forme et valide des commissaires d’exposition ? C’est ainsi que je l’ai perçu. Nous avions toutes un peu envie d’être mises dans cette case : une forme de légitimité, mais aussi une mise en relation avec les acteurs. C’était clair que faire l’École du Magasin allait m’inscrire sur un chemin que d’autres avant moi avaient fait.
Il y avait une idée de généalogie, de tradition passée de génération en génération. Après, ce que j’y ai trouvé c’était beaucoup plus important que ça. Au niveau personnel, c’est une expérience qui a vraiment changé ma vie. Je pense que mon éducation intellectuelle a vraiment commencée à Grenoble. Mais surtout, ce qui m’a amené à commencer mon doctorat quelques années après, ça a été le jour où j’ai franchi la porte de la salle en face de l’École et découvert la publication de la Session 16 autour de la méthodologie d’Harald Szeeman. Je trouvais magnifique de pouvoir approcher les archives de Szeemann, ces matériaux-là, afin de remonter à la figure de la personne derrière l’exposition et ainsi en avoir une compréhension sensible. C’est ce qui m’a donc amené à m’intéresser aux archives curatoriales, personnelles mais aussi collectives.
AS Si je reviens sur tes attentes vis-à-vis de l’École : tu n’as donc pas trouvé ce que tu cherchais mais tu as trouvé un autre chemin, c’est ça ?
MA : Oui, mais j’ai aussi trouvé ce à quoi je m’attendais. Je n’étais pas surprise, seulement affectée par la confrontation à l’autre. Cette question du collectif est restée en moi profondément. Pour moi, cette expérience a été dure parce que c’était un échec. Et je tenais beaucoup à cette dimension du collectif. En feuilletant mes archives, je me suis rendue compte qu’à un moment j’ai fait des propositions d’exposition très créatives. Mais je savais que ça tomberait à l’eau parce que les gens autour de moi ne sauraient pas comment les accueillir (sauf Katia, qui était autant « freestyle » que moi). Il y avait cette envie au départ d’être un peu plus créatif, mais ça s’est délité au fil du temps. Je me souviens qu’à un moment, on se disait qu’il fallait sortir de cette salle parce qu’on n’arrivait plus à réfléchir. On a commencé à travailler dans des cafés ou chez moi. Mais en fait, le problème c’était qu’on réfléchissait trop. Et au moment où on a commencé à entrer dans la pratique c’était un peu trop tard car le rapport entre les membres du groupe était tendu.
AS : Ce que j’entends, c’est que c’était surtout un échec du collectif. Est-ce que tu penses que si l’année n’avait pas commencé par un programme théorique lourd qui se termine par une évaluation, vous auriez eu plus de temps et l’espace pour former un collectif ?
MA : En fait, l’évaluation n’était pas sur les acquis théoriques mais sur une proposition de projet. Mais construire un projet en trois mois c’était impossible. On n’a pas eu le temps. Finalement, peut-être que l’École du Magasin était née d’une éducation alternative mais elle a été standardisée. Cette envie de produire à partir de l’expérience a été un peu castrée. Mais je pense encore une fois que c’était surtout l’échec de notre collectif : c’était au niveau des personnalités que ça se jouait aussi.
AS : Tu as dit que le partenariat avec l’école des beaux-arts n’existait pas à l’époque. Y avait-il d’autres partenariats en place ? Il y a eu des années où c’était la Biennale de Lyon.
MA : À un moment, Yves nous avait proposé de nous mette en contact avec le Fort du Bruissin ou la BF15 à Lyon, mais au final, ce n’était pas si intéressant pour nous. Il y avait un partenariat avec l’école d’art de Lyon. On a travaillé avec un groupe d’étudiants en design graphique sur notre site Internet. On est allées les rencontrer et eux sont aussi venus nous voir. On a aussi rencontré les artistes du post-diplôme de Lyon et François Piron. Riikka Kuoppala était l’une d’entre eux et on l’a invitée à participer à notre exposition. On a aussi fait une présentation de notre projet à l’école d’art de Grenoble.
Quand on est arrivées, il y avait une exposition d’Akram Zaatari au Magasin : on était très contentes de le rencontrer. L’exposition suivante, par contre, était moins réussie, celle de Anselm Riley. Et pour finir, il y a donc eu cette exposition de Pietro Roccasalva. On comprenait bien qu’il y avait ce désir de Yves de tisser des liens avec des collectionneurs et politiciens locaux. Par exemple, avant le vernissage de Pietro Roccasalva, on est toutes allées dîner chez la collectionneuse Colette Tornier.
AS : Est-ce qu’au cours de l’année on vous a invité à travailler sur d’autres projets d’exposition ? Par exemple, nous, on devait travailler sur l’exposition de Noël et sur une exposition avec un collectionneur.
MA : Pas du tout. On n’avait rien. Il n’y avait pas beaucoup de contacts avec l’équipe non plus. J’ai personnellement tissé des liens avec certains d’entre eux dont Fadma [Khadouri], mais ça reste des initiatives personnelles.
AS : J’ai une dernière question : Est-ce que selon toi il y avait un concept ou une image du commissariat qui était véhiculé par l’École à cette époque-là ? Qu’est-ce qui était transmis par rapport au métier ?
MA : Je pense qu’on avait toutes l’impression que c’était difficile de s’abstraire de cette situation et comprendre quelle image du commissaire d’exposition était véhiculée. Même maintenant, en y réfléchissant, je ne saurais pas répondre. On ne parlait pas plus que ça du commissaire d’exposition. On a rencontré des commissaires d’expositions qui étaient à la fois indépendants et institutionnels, mais cet intérêt pour les pratiques curatoriales c’est quelque chose qui pour moi s’est développé après.