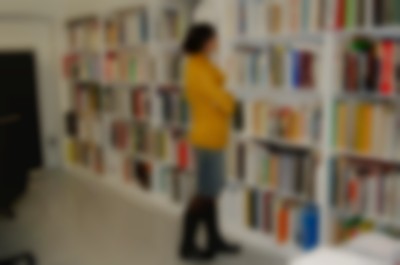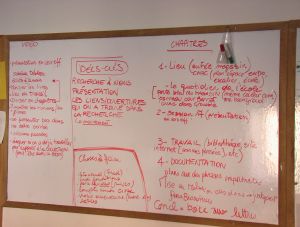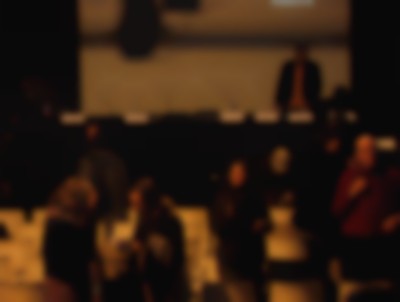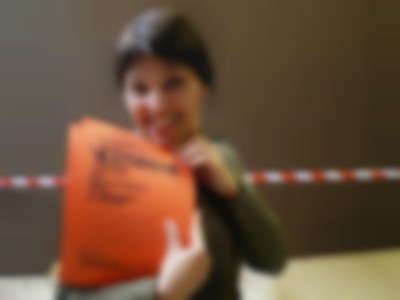Session 17: presentation
| Session | 17 (2007–2008) |
|---|---|
| Participants |
Virginie Bobin |
| Direction |
Yves Aupetitallot |
| Session website | |
| Coordination |
Alice Vergara-Bastiand |
| Tutoring |
Philippe Pirotte |
| Educational team |
Liliane Schneiter |
| People met |
Paula Aisemberg (curator, Maison Rouge) |
| Travels |
Paris (18–22 oct. 2007) |
Related archive
Documents
- Présentation du projet [pdf, 52.34 MB]
- Names and references quoted by Philippe Pirotte [pdf, 51.38 KB]
- La Maison rouge: a meeting with Antoine de Galbert and Paula Aisemberg , by Virginie Bobin (EN) [pdf, 116.39 KB]
- “La Pression de l’évènement” par Virginie Bobin (FR) [pdf, 158.44 KB]
- Mapping of important events from1980 to 1990 [pdf, 1.4 MB]
- Programme du Congrès interprofessionnel de l’art contemporain (Cipac) (FR) [pdf, 743.45 KB]
- « Fiction critique, une manière d’écrire et penser l’exposition À partir de l’activité curatoriale d’Émilie Renard et du projet “Prédilection” », par Lucile Bouvard (FR) [doc, 231.5 KB]
- Compte-rendu des activités de la Session 17 (FR) [doc, 62.5 KB]
Photographs
Point.doc
| Project |
Point.doc |
|---|---|
| Presentation |
POINT.DOC results from the work of Session 17 in the archives of Belgian collectors Annick and Anton Herbert, who were working on a project to open a foundation for their collection of major works of minimal and conceptual art and hundreds of documents dating from 1972 to the present day. Hypothesis for a history The Instant Archive Access to Document / Access Through Document |
| Format |
Exhibition of documents |
| Date |
25 May – 24 Auguest 2008 |
| Location |
Red lounge, MAGASIN-CNAC |
| With |
Contributors to Access to Document / Access Through Document: Contributors to The Instant Archive |
Related archive
Documents
- Digital invitation [pdf, 82.88 KB]
- Dossier de presse (FR) [pdf, 67 KB]
- Presentation *Access to document / Access through document* (EN) [pdf, 250.27 KB]
- Full PDF, *Access to document / Access through document*, special issue, *Horsd’oeuvre*, n° 22, June-September 2008 (FR/EN) [pdf, 2.23 MB]
- Call for reflection for ‘Access to Document / Access Through Document’ (EN) [pdf, 96.82 KB]
- Proposta de riflessione, ‘Access to Document / Access Through Document’ (IT) [pdf, 98.35 KB]
- Appel à réfléxion pour ‘Access to Document / Access Through Document’ (FR) [pdf, 101.94 KB]
- Feuille de salle (FR) [pdf, 2.38 MB]
Photographs
Point.doc (DVD)
| Project |
Point.doc (DVD) |
|---|---|
| Presentation |
Point.doc_DVD offers a filmed and commented presentation of the exhibition Hypothesis for a story from the Herbert Collection held from May 25 to August 24, 2008 in the Red lounge of the Magasin–Centre National d’Art Contemporain in Grenoble. The video is shot by the participants of Session 17, after the exhibition opened to the public.
Filmed and edited by Julia Kläring Since 1972, the Belgian collectors Annick and Anton Herbert have gathered in their factory in Ghent the major pieces of Minimal Art, Conceptual Art and Arte Povera, to which they have added an important collection of documents (photos, posters, invitation cards, books, etc.). A memorial tool and an extension of the collection of works, it could be made accessible to a public of researchers when the future Herbert Foundation opens. Projecting themselves in the shoes of the Foundation’s first researchers, the participants of Session 17 wished to question the purpose of such an archive and explore the historical inscription of the collection. |
| Format |
DVD |
| Date |
published in 2017 |
| Location | – |
| With |
Virginie Bobin |
Related archive
Pratiques et expériences curatoriales italiennes
| Project |
Pratiques et expériences curatoriales italiennes |
|---|---|
| Presentation |
Edited by Maria and Frida Carazzato and published by Presses du réel, Pratiques et expériences curatoriales italiennes is a collection of interviews with ten Italian curators: a series of testimonies on an important transition in the artistic, cultural, political and social experience of Italy, which intends to contribute to the critical reflection on curatorial practice as cultural history. |
| Format |
Publication |
| Date |
Published in 2010 |
| Location |
Presses du réel |
| With |
1:1projects |
Related archive
Documents
Media and links
Vidéo(d)rama
| Project |
Vidéo(d)rama |
|---|---|
| Presentation |
Videodrama réunit l’Ecole supérieure d’art de Grenoble et le Magasin pour une nouvelle collaboration. C’est la question de la formation artistique qui est au cœur de ce projet : celle des jeunes artistes et celle des jeunes curateurs. De jeunes artistes ont répondu favorablement à l’offre d’une soirée publique vidéo envoyée par les participants de l’Ecole du Magasin. La programmation à laquelle vous assistez ce soir est inédite. Elle résulte de plusieurs séances de visionnage, de discussion et de débats. La demande d’œuvres courtes visait à inclure un nombre élargi d’auteurs pour engager le public à prendre conscience de l’éclectisme des propositions que permet le medium numérique (sujets, formes et influences) et du brouillage temporel et hiérarchique qu’il insinue entre cinéma, télévision, art vidéo et VOD. |
| Format |
Programmation video |
| Date |
14 mai 2008 |
| Location |
Auditorium du Magasin-CNAC |
| With |
Alice Assouline |
Related archive
Documents
Photographs
Interview with Frida Carazzato
Entretien avec Frida Carazzato
par Lore Gablier
04.06.2010
Lore Gablier : Pour commencer, pourrais-tu te présenter et nous expliquer pourquoi ton choix s’est porté sur l’École du Magasin à l’époque ?
Frida Carazzato : J’ai d’abord étudié la philosophie, puis j’ai obtenu un Master en gestion des musées et service muséal. Ensuite, j’ai commencé à travailler pour un festival de films d’art qui incluait aussi un programme de performances. Et pour la première fois, j’ai commencé à travailler avec des artistes. Je me suis rendue compte que ça m’intéressait beaucoup : la manière dont un projet va se développer par rapport à un contexte et un processus de travail, et la relation et le dialogue qui faisaient partie de ce processus. J’ai donc commencé à chercher sur Internet des choses qui me paraissaient en lien avec ma recherche. Et je suis tombé sur un article dans Flash Art qui faisait un état des lieux des programmes de formation aux pratiques curatoriales en Europe et dans le monde 1 . Le premier programme cité était l’École du Magasin. Elle était présentée comme la première école en Europe de ce type, avec une méthodologie qui passe d’abord par la gratuité et la dimension de projet collectif. Je dois dire que ce qui m’a incité à postuler c’est avant tout le fait qu’elle était gratuite. J’arrivais à la fin de mes études, je venais juste de commencer à travailler et je gagnais peu. En même temps, j’avais encore besoin d’une formation. Donc j’ai postulé. Mais je ne savais absolument rien du monde de l’art contemporain et de ce qu’était cette figure du curateur. Je me rappelle très bien de l’entretien : il y avait Alice Vergara-Bastiand, Liliane Schneiter et Catherine Quéloz. Les questions qu’elle m’ont posées n’avaient pas à voir avec la figure du curateur, mais portaient sur mon parcours. Elles me posaient des questions par rapport à un processus de travail. Comment en situation j’imaginais travailler ? À la fin de l’entretien, je pensais avoir échoué. Mais finalement, j’ai reçu la réponse positive.
LG : Peux-tu me parler de ta session : comment était-elle composée ?
FC : Il s’agissait d’une petite session : nous étions six jeunes femmes. Pour ma part, je venais de la philosophie. Il y avait deux artistes, et les autres venaient d’histoire de l’art. Deux d’entre nous avaient déjà fait pas mal de projets. Si je pense au contexte de l’École, il y avait la source du groupe qui m’aidait beaucoup à apprendre, la figure d’Alice et du tuteur qui à l’époque était Philippe Pirotte. Ce sont les trois éléments qui m’ont aidé à comprendre mieux le milieu, la situation, et qui faisaient partie de mon parcours d’apprentissage.
LG : Quelle était le rôle de Philippe Pirotte ?
FC : Il était beaucoup présent dans les premiers temps. Au début, on ne savait pas sur quel sujet travailler. Yves [Aupetitallot] nous a donné le sujet autour de Noël. Au début, Alice a organisé des rencontres avec des artistes, des curateurs indépendants, ou des petits collectionneurs. Juste pour comprendre mieux le système de l’art. Philippe Pirotte a commencé à nous donner des informations en rapport à la scène artistique belge. Après, le sujet de notre recherche était la collection de Annick et Anton Herbert. En tant que belge, il avait beaucoup de références. Il nous a accompagné lors de notre première visite à la collection Herbert. Après, je pense qu’il y a eu des incompréhensions avec la gestion du projet ou d’autres empêchements, et malheureusement il était beaucoup moins présent. Yves voulait faire un livre sur la collection Herbert, mais ce format franchement à l’époque ne nous intéressait pas. La session précédente avait publié le livre sur Harald Szeemann et on savait que c’était un projet très intensif. Mais ce n’était pas ça notre problème. Le problème c’est qu’on ne comprenait pas trop si on travaillait pour un projet fortement voulu par Yves, ou s’il s’agissait pour nous de comprendre mieux la figure du curateur. Je ne cache pas que il y eu des tensions sur ce sujet avec le directeur aussi.
LG : Le groupe lui-même était-il solidaire ?
FC : Absolument. Nous étions un petit groupe et cela aidait. On a vraiment travaillé ensemble. C’est naturel qu’à l’intérieur d’un groupe il y ait des affinités entre certaines personnes qui se tissent. Alice était une figure très importante. Ce qui nous a manqué, ce sont Catherine et Liliane, qui sont venues à Grenoble une fois, et que l’on a rencontrées de nouveau à Genève. Après, on a demandé plusieurs fois de les inviter, mais apparemment il semble qu’il y avait des malentendus entre l’école et le centre d’art.
LG : Tu décris le fait qu’à un moment, dans le courant de la formation, un projet est soudain imposé. Avant que cela soit le cas, comment les premiers mois se sont-ils déroulés ?
FC : Pour moi c’était vraiment étrange. Je viens d’une formation académique italienne où les professeurs te font la leçon et lors de l’examen, tu vas répéter ce que tu as appris. Même au cours de mes études de philosophie, il n’y avait pas de véritables moments de discussion et de critique. Pour moi, c’était une nouveauté : être dans un groupe dans lequel on est toutes égales et où on bénéficiait d’inputs de personnes qui n’étaient pas des professeurs. Dans le groupe, nous avions toutes des expériences et des histoires différentes et il s’agissait de mettre en partage nos connaissances respectives. Pour moi, au début, c’était difficile. On avait une salle avec des ordinateurs, une machine à café, une petite bibliothèque, une connexion Internet. Au milieu, il y avait une grande table qui invitait à l’échange. On avait un horaire d’entrée et de sortie, et on devait structurer nos journées nous-mêmes. Au début, c’était difficile car je n’étais pas habituée à ce type de méthodologie. Au fur et à mesure, j’ai compris comment faire. Et je peux dire seulement a posteriori que j’ai vraiment apprécié cette méthodologie, et que j’ai cherché à garder dans ma pratique. Aujourd’hui, je travaille dans une institution, et je développe encore quelques rares projets indépendants. Et si je repense à la méthodologie de l’École, je dois dire qu’elle m’a beaucoup nourrie. Parfois, je cherche à mettre en place une méthodologie similaire dans le contexte du quotidien de l’institution muséale. Mais ce n’est pas facile ! Une institution muséale a un fonctionnement très hiérarchique, ce qui n’était pas le cas à l’École.
LG : Quelles étaient vos relations au centre d’art, et à son équipe ?
FC : On a surtout entretenu des liens avec les techniciens et l’équipe du service de communication. Avec Yves, il n’y avait pas vraiment d’échange. Pour nous, il était le directeur, et donc, forcément, on le percevait dans cette hiérarchie. En plus, il y a eu des tensions autour du projet qui nous ont encore davantage éloigné de lui. Toutefois, j’appréciais beaucoup par exemple les réunions d’équipe qu’il gérait autour des projets d’exposition du centre d’art. Pour moi c’était très intéressant d’y assister en tant qu’observatrice, et de comprendre le fonctionnement d’un centre d’art et les compétences des différents services. Après, on n’a pas véritablement participé aux accrochages des œuvres, ce qui était un peu dommage. Une autre chose que j’ai trouvé intéressante c’était de devoir construire un budget chaque fois qu’on partait en voyage. Quand on revenait, il fallait réunir toutes les factures et clore le budget pour l’administration. C’est une chose un peu banale mais ça nous aidait aussi. Comme c’est souvent le cas, on a une perception a posteriori différente, et par exemple, maintenant j’arrive à comprendre et à encadrer aussi la dimension hiérarchie en fonction d’une « machine » organisatrice.
LG : Peut-être pourrais-tu nous parler des projets que vous avez réalisés au cours de l’année. Il y en a eu plusieurs, si je ne me trompe pas.
FC : Oui. Au début de l’année on a travaillé avec Ludovic Burel et l’École d’art de Grenoble autour d’un projet de programmation de vidéos. On a rencontré les étudiants de l’école, et pour moi ce fut une nouvelle expérience : rencontrer les artistes et discuter de leur travail. La sélection de vidéos a été présentée au Magasin. Cette programmation s’appelait « Vidéo(d)rama ». Avec Alice, on a vraiment appris comment faire une sélection et la communiquer. Ça peut sembler très didactique, mais pour nous c’était vraiment important. L’autre projet portait sur la collection Herbert, et les voyages qu’on a faits et nos rencontres avec les collectionneurs à Gand. Julia était une artiste et donc elle a tout enregistré en vidéo. Elle était aussi portée sur la performance et cela nous a aidé à trouver un médium qui nous permettait de raconter à la fois la recherche et faire le projet. En effet, on devait travailler sur les archives de la collection Herbert mais on ne pouvait pas utiliser les documents et œuvres originaux. On a donc commencé à se demander ce qu’on pouvait faire. Le projet s’est développé autour de notre expérience : nos voyages, les entretiens qu’on a réalisés, les photos qu’on a prises, et les photocopies qu’on a faites. Il s’agissait d’épéhméras, d’une certaine façon. On s’est ensuite posé la question de la mise en espace : comment raconter cette recherche à d’autres gens qui n’y ont pas pris part ? C’était le vrai défi pour nous. D’un côté, on savait que les collectionneurs attendaient un résultat car à l’époque, ils travaillaient sur l’ouverture de la fondation Herbert. Et nous, parallèlement, on donnait au public notre recherche.
LG : Et votre contribution au magazine horsd’oeuvre ?
FC : On avait commencé à réfléchir sur la question des archives dans l’art contemporain. Une fois qu’on a appris qu’on devrait travailler autour du concept d’archives, on a commencé à s’intéresser aux artistes et curateurs qui avaient travaillé cette question. L’une d’entre nous, Lucile, avait un contact avec le magazine, et on nous a offert la possibilité d’éditer un numéro. Il s’agissait pour nous de porter cette réflexion sur les archives dans un format tel que celui du magazine gratuit, et largement diffusé. Quand j’ai commencé à travailler à l’intérieur du musée, après mon expérience à l’École, je me suis aperçue qu’il s’agissait d’un sujet très important dans l’art contemporain. Il y a beaucoup d’artistes et de curateurs qui développaient des projets sur la question des archives et de leur réactivation. Je me suis alors rendu compte à quel point notre projet résonnait à l’intérieur du contexte de l’art contemporain.
LG : Penses-tu qu’il y ait un lien entre cette question des archives et la figure du curateur ? Lorsque tu arrives à l’École, ce qui t’intéresse c’est de travailler avec des artistes. Et tu te retrouves à travailler avec des archives.
FC : Si je dois être sincère, le fait de me retrouver à nouveau dans un contexte de recherche m’a perturbée au début. J’avais l’impression de ne pas sortir d’un contexte académique. Mais à travers horsd’oeuvre et à travers l’articulation du site Internet, je me suis sentie responsable d’un travail d’écriture, et donc auteure. Et cela s’assimilait davantage à ce que je commençais à percevoir de la figure du curateur. Cette expérience d’écriture m’a permis d’ajouter un autre élément à ce que je définissais comme pratique curatoriale.
LG : Quelle dynamique y avait-il au sein du groupe ?
FC : Julia était artiste et elle était plutôt portée sur la vidéo. Virginie et Lucile s’intéressaient à l’écriture. Et moi, c’était l’organisation du matériel. On était toutes au même niveau sur un travail d’écriture, mais sur des aspects différents. La pratique curatoriale c’était vraiment d’envisager un sujet et de le réécrire, de chercher des formes différentes qui s’adressent à différents publics. La question du public était importante. Il y avait le public de l’exposition qu’on présenterait au Magasin, le public qui lirait le numéro d’horsd’oeuvre, celui qui accèderait au site Internet.
LG : Comment était perçu le rôle du curateur dans ta session ?
FC : On en a beaucoup discuté. Quand on a commencé à réfléchir aux archives Herbert, c’était toujours la même question : qu’est-ce que nous pourrions faire ? Alice et Philippe Pirotte nous ont aidé à prendre une position. Et je pense que c’était une position curatoriale. Au départ, Yves souhaitait qu’on réalise une publication. Mais pour nous, il était plus intéressant d’envisager d’autres formats pour parler de ces archives.
LG : La pratique curatoriale en effet invite à poser la question des formats.
FC : Oui. Des formats mais aussi des formes de narration. Par exemple, comment parler de ces archives ? S’agit-il de présenter les artistes qui n’en font pas partie ? Va-t-on les organiser d’une manière chronologique ? Quels paramètres d’écriture va-t-on mettre en place ?
LG : En effet, la manière dont vous avez traité ces archives, plutôt que de simplement les classifier, a consisté à les questionner du point de vue des histoires qu’elles racontent sur la manière dont elles s’inscrivent dans une histoire de l’art contemporain qui est sans doute beaucoup plus riche et complexe. La collection Herbert offre un point de vue qui correspond à une certaine scène artistique européenne et nord américaine.
FC : Tout à fait. Et sans doute, nous étions encore trop jeunes. Si je pense à la collection Herbert aujourd’hui, je vois beaucoup de possibilités de la critiquer.
LG : C’est aussi quelque chose d’assez typique de l’École : malgré les riches apports théoriques d’Alice, Catherine et Liliane, on est toujours resté il me semble dans des références géographiquement localisées. Et c’est peut-être pour moi la faille de l’École dans la possibilité qu’elle aurait pu avoir de faire place en Europe à d’autres continents.
FC : On avait justement touché mais pas forcément analysé toute la période de la fin des années 1980, et le tournant des années 1990. Voir au sein des archives ce qui s’est passé après la chute du mur de Berlin. C’était présent dans l’exposition, mais finalement on n’a pas réussi à la questionner. Je me rappelle que Philippe Pirotte nous a posé la question : Va-t-on voir ce qui ne fait pas partie des archives ? Et c’était déjà là déplacer le point de vue. Pour nous, il y avait aussi la question de la Fondation : Pourquoi une Fondation ? Quel en sera le public ? Quelle histoire va-t-elle raconter ? Ça a été le point de départ de la recherche que Maria et moi avons décidé de mener sur la question des fondations en Italie. C’était une petite recherche qu’on n’a pas terminée. Au final, on a réalisé des entretiens avec des curateurs, et ça a pris la forme d’un publication : Pratiques et expériences curatoriales italiennes. Alice en effet nous avait encouragées à nous interroger sur la figure du curateur dans le contexte italien. On a commencé avec la Fondation Pistoletto parce que les Herbert disaient qu’ils s’inspiraient beaucoup de ce modèle. On est donc allé interroger Michelangelo Pistoletto, et ensuite, on a contacté d’autres fondations par courriel. L’idée c’était de faire un petit article pour notre site Internet. Puis on a commencé à changer de direction, et interrogé des curateurs. Yves a ensuite eu l’idée de faire cette publication. Mais ce n’était pas un projet de l’École. C’était un projet de Maria et moi.
LG : Quand avez-vous initié ce projet ?
FC : Vers la fin de la session. On a commencé à envoyé des emails à différents curateurs en Italie qui travaillaient dans différents contextes – institutionnels, indépendants, associatifs. On a sélectionné dix de ces entretiens pour la publication.
LG : Pour finir, y a-t-il quelque chose qui rétrospectivement te semble avoir été un obstacle ou une faiblesse ?
FC : Quelque chose qui nous a beaucoup manqué c’était la présence de Catherine et Liliane. Nous les avons rencontrées lors de notre entretien puis au début de notre session. Elles nous ont donné l’impression d’être vraiment deux personnes importantes du point de vue curatorial. Ce qui m’a aussi manqué personnellement c’était plus de références théoriques. On avait une bibliothèque et une bibliographie. Mais quand tu n’es pas obligé de lire parce que tu n’as pas une véritable deadline, je trouve ça difficile. Et finalement, je pense que nous aurions pu avoir plus de rencontres et d’échanges avec la scène artistique locale.
Interview with Virginie Bobin
Entretien avec Virginie Bobin
par Estelle Nabeyrat
Virginie Bobin : J’ai fait partie de la session 17, qu’on appelait en plaisantant Sécession 17. C’était une session composée exclusivement de femmes. Nous étions six : Julia Kläring, une artiste autrichienne ; Maria Garzia et Frida Carazzato, deux historiennes de l’art italiennes ; Lucile Bouvard, une française issue des Beaux-arts de Nantes ; et l’artiste uruguayenne Silvana Siveira, qui vivait auparavant en Floride. Notre coordinatrice était Alice Vergara-Bastiand, et c’était, je crois, son avant-dernière année à l’École, en 2007-2008.
Estelle Nabeyrat : Qu’est ce qui à l’époque t’a motivé à postuler à l’École ? Quelles étaient tes attentes et comment s’est passé le démarrage de l’École ?
VB : C’est Julien Blanpied qui m’a parlé de l’Ecole pour la première fois. Je l’ai rencontré lors d’un stage au Mac/Val, quelques mois avant l’ouverture du musée en 2005. Lui y travaillait comme assistant d’exposition. Julien m’avait parlé de l’École avec énormément d’enthousiasme. À l’époque j’étais en Master à l’École du Louvre et je commençais à en avoir un peu marre de l’enseignement académique, très axé sur les musées. Au même moment, le concours national du patrimoine s’ouvrait pour la première fois à des Européen·ne·s. C’était pour moi révélateur d’un contexte dans lequel je ne voulais pas continuer : très franco-français, très institutionnel. L’École du Magasin me faisait un peu rêver. J’avais aussi postulé aux masters Expositions de Paris I et Paris IV, mais il y avait quelque chose d’expérimental dans l’auto-organisation revendiquée par l’Ecole qui m’attirait. J’avais déjà monté une petite association avec d’autres étudiant·e·s et j’avais ce besoin de faire et de faire collectivement. Il me semblait que c’était la promesse que portait l’École. Que ce ne soit pas une école diplômante mais une école de pensée, c’est quelque chose qu’Alice Vergara-Bastiand défendait beaucoup et qui transparaissait sur le site internet. La dimension d’autogestion, le fait que les participant·e·s pouvaient organiser leur année, le rapport au projet, ça m’a énormément marquée par la suite. Je n’en pressentais pas encore les implications, mais je trouvais ça stimulant. Et puis j’avais fait toutes mes études à Paris : j’avais envie d’aller voir ailleurs. J’ai donc postulé avec un horrible projet et finalement ça a marché. C’est comme ça que je me suis retrouvée à Grenoble.
Je me souviens très bien de ma première journée au Magasin, de la rencontre avec les autres participantes et avec Alice, qui était un personnage impressionnant de rigueur et d’exigence mais qui était aussi très maternelle avec nous. C’est une personne qui m’a énormément apporté humainement, intellectuellement et personnellement. L’École, c’est quelque chose de très humain. C’était avant tout une rencontre avec les autres participantes, un apprentissage à travers ces cinq autres personnes avec lesquelles on a vite compris qu’on allait passer beaucoup de temps. Voir comment une dynamique de groupe pouvait émerger. Voir comment chacune se présentait, présentait son parcours. Bien avant de penser à comment nous allions faire projet ensemble, il fallait envisager comment passer ce temps ensemble. C’est un apprentissage important de l’École. Alice nous avait laissé le temps de faire connaissance et de découvrir les parcours et les « compétences » de chacune our voir comment cette combinaison de caractères, de profils et d’expériences allait pouvoir se faire. Cela m’a beaucoup influencée par la suite, notamment dans le travail avec des étudiant·e·s que j’ai pu mener à Bétonsalon.
Au cours de l’année, notre groupe s’est scindé en deux. Je crois qu’il y a eu dans toutes les sessions des rapports parfois tendus, voire conflictuels. Il est arrivé que des gens partent en cours de route. Nous sommes toutes restées, mais il y a eu une scission qui a un peu entamé le travail collectif. Malgré tout, on a réussi à maintenir le groupe jusqu’au bout, à composer avec nos différends. C’est une qualité de l’Ecole qui me paraît très importante.
Au début de l’année, Alice avait beaucoup insisté sur le site internet. C’était très important pour elle la manière dont on se présentait à l’extérieur, c’était comme l’acte de naissance de la session. Imaginer un site, concevoir son architecture et son contenu, se présenter — ce qui m’a d’ailleurs causé des soucis par la suite car mon e-mail perso et ma terrible petite présentation sont restés en ligne pendant des années ! Le site a donc été le premier acte collectif de notre session.
EN : Et qui était votre tuteur ?
VB :C’était Philippe Pirotte, qui dirigait à l’époque la Kunsthalle de Bern. Il a tenu ce rôle une année. Catherine Quéloz et Liliane Schneiter, théoriciennes et enseignantes à la HEAD de Genève, sont aussi intervenues, mais beaucoup moins qu’elles n’avaient pu le faire pour des sessions précédentes. Des tensions et des conflits de pouvoir s’étaient installées entre l’École et la direction du Magasin. Je pense que Catherine et Liliane avaient moins vocation à soutenir les nouvelles orientations que la direction du Magasin entendait donner à l’École. Ça a été une déception pour moi, car elles avaient participé au jury et j’attendais beaucoup de leur expertise sur les questions féministes, politiques etc… J’étais encore dans une dynamique scolaire ancrée dans mon parcours universitaire classique et j’espérais qu’elles m’aideraient à la déconstruire. Mais j’ai gardé contact avec elles par la suite et elles ont toujours été disponibles et bienveillantes.
Philippe, lui, est venu plus souvent. Son rôle, en tant que tuteur, était davantage de nous aider à monter notre projet. Comme nous devions travailler avec des collectionneurs belges qu’il connaissait bien, il devait aussi agir comme intermédiaire. Il ne venait pas pour nous donner des leçons. Il était à l’écoute et nous renvoyait des choses pour nous faire avancer. Après l’école, nous avons développé une relation d’amitié et de travail et il est devenu une sorte de parrain pour moi. L’année d’après l’Ecole, il m’a embauchée comme assistante sur un projet d’exposition dans un incroyable château en Irlande. Puis Julia Kläring et moi avons écrit un texte pour le catalogue d’une exposition qu’il organisait à Bern sur Alan Kaprow. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup appris et qui continue de le faire aujourd’hui. Bien que nous ayons des approches assez différentes du travail curatorial, nous avons un échange très fructueux qui a pris racine à l’Ecole du Magasin.
EN : Et du coup en ce début d’année, en plus du site, vous aviez un voyage à organiser ensemble ? Comment ça s’est passé ?
VB : Le voyage n’est pas arrivé tout de suite. On a fait plusieurs déplacements à Lyon, Annecy, Valence… et ça c’était super bien. Ayant fait, encore une fois, toutes mes études à Paris, je découvrais d’autres centres et d’autres réseaux, en Rhône-Alpes, en Suisse… Alice insistait beaucoup là-dessus et elle nous incitait notamment à tisser des liens avec les écoles d’art avoisinantes, à rencontrer les jeunes artistes, les actrices et les acteurs locaux. Nous fréquentions beaucoup l’École du Baoum, un lieu créé par des élèves échappés des Beaux-arts de Grenoble, comme Jean-Sébastien Tacher, et qui a duré environ deux ans. Leur acte de naissance avait été de creuser un trou dans le mur de l’école d’art. Ils organisaient plein de petits événements. C’était pour nous une respiration car il ne se passait pas énormément de choses à Grenoble à ce moment-là. On a tissé des liens forts avec cette bande. C’est aussi l’année où s’est créé le OUI, un lieu d’exposition alternatif qui montrait les œuvres de jeunes artistes de Grenoble et des environs. J’y ai rencontré Stéphane Sauzedde, un autre de mes parrains et amis, avec qui je travaille encore étroitement aujourd’hui. Encore une très belle relation qui été permise par l’École. Nous nous sommes aussi rendues à l’Ecole des beaux-arts de Lyon, où tu travaillais à l’époque comme coordinatrice du post-diplôme, pour faire des visites d’atelier et rencontrer les participant·e·s.
Ça a commencé comme ça, par la cartographie d’un réseau que nous ignorions toutes. Et donc le voyage a eu lieu plus tard, en Belgique, avec l’aide de Philippe. Il avait co-fondé le lieu d’art Objectif Exhibitions à Anvers et connaissait toute la scène belge. C’était l’année d’ouverture du Wiels à Bruxelles et d’Extra City à Anvers, plein de lieux ouvraient en Belgique et beaucoup de gens venaient voir. Je me souviens d’un moment très drôle, dans une galerie d’art à Anvers, où nous nous sommes trouvées nez à nez avec les participant·e·s de la formation curatoriale « rivale » De Appel. En nous voyant face à face dans le petit espace, la galeriste a imité le sifflement du duel dans Le Bon, La Brute et le Truand !
Cette rencontre m’a laissé un sentiment un peu frustant parce que l’École étant gratuite, nous avions un budget beaucoup plus limité que des formations comme De Appel. Les élèves de De Appel revenaient de Singapour, Hong Kong, du Chili, et je me rappelle que nous nous étions senties un peu comme les « parentes pauvres » des programmes curatoriaux. Nous étions jalouses de leurs opportunités de réseau, à l’époque où ça nous semblait très important. Plus tard, j’ai réalisé que la gratuité de l’École faisait aussi partie de sa spécificité et qu’il fallait évidemment la défendre. Si l’École avait été payante, je n’aurais pas pu y participer, ni certaines de mes collègues. C’était donc un programme beaucoup plus inclusif, moins élitiste que d’autres formations. Nous avions tout de même rencontré toute l’équipe du Wiels et d’Extra City, visité le studio de Wim Delvoye, échangé avec des curatrices et des artistes belges, c’était vraiment intéressant. Nous avions tout organisé nous-mêmes, avec un tout petit budget, en dormant dans des chambres collectives, etc.
EN : Pourquoi la Belgique ?
VB : Notre projet curatorial devait tourner autour de la collection privée des Herbert à Gand.
EN: Ce qui est un élément important car ce projet ne venait pas d’un choix collectif. C’était une commande du Magasin.
VB : D’Yves Aupetitallot, le directeur du Magasin, oui.
EN : Comment s’est passée cette proposition ?
VB : Cela n’a pas été facile. Très vite, nous nous sommes rendu compte qu’il existait de fortes tensions entre le Magasin et l’Ecole, hébergée au sein du centre d’art mais qui revendiquait son indépendance. Nous ne nous y attendions pas du tout. Dès le début, nous avons été confrontées à des réalités institutionnelles compliquées et assez violentes, car elles frappaient directement les personnes avec lesquelles on travaillait. Cela rejaillissait sur nous car un certain nombre de choses se trouvaient bloquées ou grippées du fait d’un désaccord profond et de plus en plus visible entre l’Ecole telle qu’Alice la défendait et ce qu’Yves Aupetitallot souhaitait transformer.
Le fait qu’on nous impose un objet de travail était en contradiction avec le projet pédagogique défendu sur le site de l’Ecole du Magasin, pour lequel nous avions candidaté. Nous étions donc déçues et frustrées. Rétrospectivement, c’était plutôt intéressant car nous nous sommes sans doute moins dispersées. Un groupe avec des personnes si différentes et des centres d’intérêts si variés doit nécessairement faire consensus autour d’un objet de travail. Cela aurait été aussi compliqué, d’une certaine manière, de devoir inventer un projet commun de toutes pièces. Alice partageait avec nous les processus qui avaient amené telle ou telle session à faire leur projet et elle nous avait fait comprendre que cela pouvait parfois être décevant et limitant.
EN : Avais-tu l’impression qu’Alice cherchait des arguments pour vous convaincre des aspects positifs du projet ?
VB : Pas nécessairement. Alice était très pédagogue et très honnête : elle mettait tout sur la table en nous disant, « Voilà, il y a cette situation, voilà les contraintes et les possibilités ». Ou bien, elle nous les faisait découvrir par nous-même. Elle avait un vrai rapport à la maïeutique. Elle posait des cadres qui nous amenaient à forger nous-mêmes nos conclusions. Elle était en même temps très ouverte sur ce qui avait pu fonctionner ou pas lors des sessions précédentes. Elle nous mettait en garde, elle nous déshabillait un peu de notre naïveté. Elle n’était pas tendre avec nous, mais c’était toujours pour nous faire avancer.
Au départ, ce projet a donc plutôt été une source d’opposition de notre part. Je me suis beaucoup renseignée après sur les formations curatoriales, et j’ai l’impression qu’il y a un schéma récurrent : l’arrivée, l’ébullition, puis conflit/opposition envers la coordination ou la direction, et enfin résolution du conflit. Il y a un moment où le groupe se mutine et veut prendre son autonomie et finalement une résolution apparaît. C’est comme si ces processus, étaient inévitables, quel que soit le cadre d’apprentissage.
Dans notre cas, ça a été d’autant plus difficile du fait que nous étions un groupe de femmes, étudiantes, face à un directeur condescendant dont nous percevions le comportement comme extrèmement sexiste. Nos échanges avec lui n’étaient ni agréables, ni enrichissants. Nous comprenions très bien l’intérêt pour la direction du Magasin de faire travailler l’École autour d’une collection privée importante, de qualité muséale. Les Herbert s’apprêtaient à ouvrir leur propre fondation. Nous nous sentions instrumentalisées.
Après avoir finalement accepté de travailler sur cette collection, les choses n’ont pas été simples pour autant. Les Herbert étaient des gens précis, avec une vision très organisée de leur collection, et ils avaient leurs propres attentes par rapport à cette collaboration. Mais nous avons fini par nous entendre et par faire un projet qui s’est avéré enrichissant pour eux comme pour nous. Au final, au-delà de tous les enjeux de pouvoir, diplomatiques, politiques et économiques impliqués par cette collaboration, les choses se sont relativement bien passées. Ce qui, je crois, nous avait aussi un peu déçues, c’est qu’il s’agissait d’une collection d’art des années 1960-1970. C’était une magnifique collection, mais c’était un objet d’histoire de l’art. Nous n’avons pas travaillé avec de jeunes artistes, ou presque pas. Et c’était quelque chose qui m’avait déjà beaucoup manqué à l’Ecole du Louvre car, même dans l’option Art contemporain, on avait peu de contact avec des artistes de notre génération ou un peu plus âgé·e·s. Travailler à nouveau avec des archives, ce n’était pas vraiment ce que nous attendions ou espérions, mais ces archives étaient tellement fabuleuses qu’au final nous avons pris conscience de la chance de travailler avec ce matériau.
Les Herbert avaient pris le soin de classer leurs archives entre : 1) artistes collectionné·e·s (principalement européen·e·s et états-unien·ne·s), 2) artistes qu’ils envisageaient de collectionner, 3) artistes qu’ils ne voulaient pas collectionner mais dont ils suivaient le travail. Toutes et tous de la même époque et pour lesquel·le·s ils avaient donc une archive énorme et parfaitement organisée. Nous avons remarqué que dans le 3ème classement se trouvaient toutes les artistes femmes et non-occidentales. Alors nous avons fait un projet autour de cela, c’est là que nous avons posé notre regard critique. Les Herbert ont d’abord été surpris, car leur collection était célébrée pour ce qu’elle comportait, par pour ses manques ! Mais ils ont finalement accueilli cela avec plaisir. Nous avons fait un projet sur ce qui se cachait dans les archives de la collection et qui racontait une tout autre histoire. On a eu la satisfaction de pouvoir pirater un peu la commande.
Ça revient à ce que je disais plus tôt sur le processus et le rapport d’opposition : si le collectif se construit en bonne intelligence, on arrive toujours à produire quelque chose de stimulant, tout en intégrant les différents enjeux, les oppositions et les problématiques que chacune avait envie de traiter au cours de cette année. Donc au final, ça a été une année épuisante — d’abord mentalement car ce conflit institutionnel latent nous a beaucoup pesé — mais en même temps, cela a été hyper formateur car ce conflit nous a fait prendre conscience des enjeux (de pouvoir, d’argent, d’éthique) qui traversent aussi bien les écoles que les centres d’art et qui n’étaient pas autant discutés qu’aujourd’hui. Malgré tout, Alice nous incitait beaucoup à suivre les projets du Magasin et à nous y impliquer. En réalité, il y avait peu d’interaction entre le Centre d’art et l’Ecole, qui partageaient pourtant les mêmes locaux. J’étais surprise de constater à quelle point l’Ecole était considérée comme une pièce à part.
EN : Donc sur les activités du Magasin, il n’y avait pas de participation de l’Ecole ?
VB : On a à chaque fois rencontré les artistes de la programmation : Kelley Walker, Andro Wekua et Adel Abdessemed. Trois stars masculines. On voyait bien la séparation entre le projet artistique du Magasin, avec des artistes hommes portés par de grosses galeries et des expositions spectaculaires qui nécessitaient beaucoup d’argent ; et de l’autre une Ecole construite autour d’un projet féministe critique, avec une équipe de femmes désireuses d’en découdre avec le patriarcat, haha ! Ce qui ne nous a pas empêché de faire de bonnes rencontres avec Kelley Walker, par exemple, une personne très accessible et généreuse. Nous avons aussi eu l’occasion de présenter une programmation de films en partenariat avec l’Ecole d’art. Et notre projet de fin d’année a été présenté au Magasin, dans une petite salle à gauche de l’entrée qui était à l’époque une salle de documentation. Dans mon souvenir, c’était la première fois que l’Ecole faisait un projet à l’intérieur du Magasin. En tout cas, ça avait été une sorte de victoire.
EN : Il y a eu d’autres sessions avant, mais jamais dans cet espace. C’était sans doute un combat de chaque année !
VB : Après, la direction avait sans doute intérêt à présenter la collection Herbert au Magasin. Même si ce n’était qu’une exposition de photocopies couleur !
EN : À ce propos, en ce qui concerne le budget, vous étiez au courant du montant qui vous était alloué ?
VB : C’est ce que j’avais cru sur la base de la présentation de l’Ecole. J’avais imaginé que nous allions arriver et qu’on nous dirait : voilà la somme allouée pour l’Ecole, vous pouvez faire vos invitations etc. Mais en fait, non. Nous avions des petits budgets à gérer comme pour le voyage, le projet final…
EN : Te souviens-tu du montant pour le projet final ?
VB : Je ne m’en souviens pas, mais ce n’était pas beaucoup ! On avait bien rigolé en faisant un genre de piratage de meubles de Donald Judd — un artiste représenté dans la collection Hebert. On avait trouvé dans leurs archives un catalogue de Judd avec ses projets d’architecte et de designer d’intérieur. J’ai demandé à mon père, qui est menuisier amateur, de reconstituer le plan d’un des meubles qu’on a ensuite construit avec l’équipe technique du Magasin. C’était donc une de nos collaborations avec l’équipe. On avait tiré parti des contraintes budgétaires pour s’amuser un peu.
EN : Peux-tu me citer quelques intervenants que vous aviez pu inviter ? J’imagine que vous aviez pu en convier quelques-uns ?
VB : Dans mon souvenir, pas beaucoup. Je me souviens de peu d’intervenant·e·s, sauf d’une, qui a marqué durablement mon existence : c’était Yvanne Chapuis, qui est venue parler des Laboratoires d’Aubervilliers et de leurs méthodes de travail. À l’époque, je ne connaissais pas ce lieu et ça m’avait bouleversée. Elle nous a parlé du projet de Patrick Bernier et Olive Martin, Plaidoirie pour une jurisprudence, et c’est comme ça qu’à la sortie de l’Ecole, je suis allée frapper à la porte des Labos pour qu’ils me prennent en stage. Ils ne cherchaient pas de stagiaire à ce moment-là et je suis rapidement partie à New York ensuite, comme Curatorial Fellow pour Performa. Mais j’étais tellement fascinée par ce projet d’Olive et Patrick que j’en ai parlé au curateur Joseph Del Pesco, qui avait créé une archive en ligne de performances racontées en vidéo par des commissaires et des artistes. Et il a donc enregistré mon récit de Plaidoirie pour une jurisprudence. À mon retour des États-Unis, j’ai passé un entretien pour devenir Coordinatrice des projets aux Labos. Grégory Castéra, l’un des co-directeurs, avait fait une recherche en ligne et il est tombé sur cette vidéo. Il m’a dit plus tard que ça avait joué en ma faveur. Par la suite, j’ai pu remonter la Plaidoirie à Rotterdam avec Patrick et Olive. Cette œuvre découverte à l’Ecole du Magasin m’a donc longtemps accompagnée et m’a même permis de trouver du travail !
De manière générale, pour ce qui est du budget et des intervenant·e·s, c’est ce que je disais un peu en plaisantant par rapport à De Appel : on avait le sentiment qu’il n’y avait finalement pas beaucoup d’argent, et donc pas autant de possibilités qu’on espérait. Rétrospectivement, c’était un sentiment égoïste et naïf, car, encore une fois l’Ecole était gratuite. Une fois que tu commences à travailler en institution, tu te rends beaucoup mieux compte des enjeux budgétaires, de la charge de travail énorme que requiert la recherche de financements et des contreparties qu’ils impliquent. On n’avait pas encore pleine conscience de ces réalités-là, mais peut-être que ça aurait été différent si le budget global avait été partagé de manière transparente avec nous. Je sais que c’est le cas par exemple dans le Master artistique dirigé par Nils Norman au Danemark. Au début de l’année, il ouvre le budget et tou·te·s les étudiant·e·s savent combien coûte le salaire des profs, quel budget est disponible pour faire des invitations etc. C’est aussi ce qu’a fait Laurence Rassel, la directice de l’Erg, qui a rendu public tout le budget de l’école. Je pense que tu envisages le budget plus intelligemment quand tu as une vision d’ensemble des coûts concrets d’un programme, du salaire des profs, du coût de la maintenance etc. Je trouve que c’est un enjeu pédagogique important.
EN : Tu as beaucoup collaboré par la suite avec Julia Kläring qui faisait partie de ta session. Tu peux nous parler des suites de cette rencontre ?
VB : Nous partagions un intérêt fort pour la performance. Elle, depuis son travail d’artiste, et moi, depuis mes recherches en histoire de l’art. Nous avons donc créé ce collectif intitulé bo-ring — comme Bobin et Kläring. Nous avons intitulé notre premier projet « Performing Memory », parce qu’on s’intéressait à la manière dont la performance pouvait être une forme de document, d’outil d’investigation et de réécriture de l’histoire. Ce projet a d’abord pris la forme d’une série d’entretiens avec des artistes et des chercheur·euse·s, puis de séminaires et de conférences, et d’une petite publication. Nous avions initié le projet ensemble mais nous avons aussi organisé des choses chacune de notre côté sous l’étiquette « Performing Memory » — puisque nous n’étions pas dans la même ville ni dans le même pays. On a aussi monté ensemble un projet d’exposition à Bétonsalon, sur un autre sujet. Notre collaboration a duré deux ou trois ans. Ça a été un vrai moteur. J’ai gardé de l’École ce besoin de travailler de manière collective et de ne pas forcément être l’auteure singulière d’un projet. De toujours questionner les formes de travail et les manières de travailler ensemble. C’est quelque chose que j’ai eu la chance de retrouver aux Laboratoires d’Aubervilliers par la suite. Je place vraiment les Labos dans la continuité de l’expérience à l’École. Ça m’a aidé à construire une pratique et une éthique de travail : toujours justifier ses choix, les mettre en discussion, partager, travailler de la manière la plus horizontale possible. bo-ring était aussi une manière de poursuivre tout cela, tout en ne sachant pas à l’époque ce que j’allais faire, quelle économie nous allions trouver… Avant de partir à New York, six mois après la fin de l’École, cette collaboration m’a permis d’inventer mon activité curatoriale.