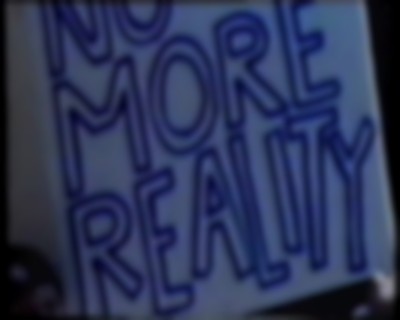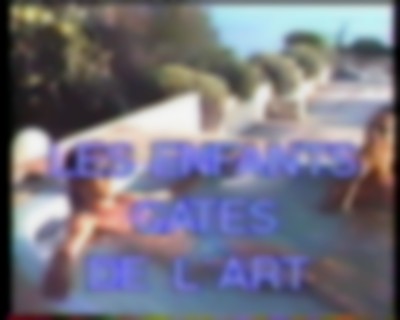Session 13: presentation
| Session | 13 (2003–2004) |
|---|---|
| Participants |
Katia Anguelova |
| Direction |
Yves Aupetitallot |
| Session website | |
| Coordination |
Alice Vergara-Bastiand |
| Tutoring |
Vincent Pécoil |
| Educational team |
Liliane Schneiter |
| People met |
Joël Bartolomeo |
| Travels | – |
Related archive
Royal Wedding
| Project |
Royal Wedding |
|---|---|
| Presentation |
Royal Wedding is an exhibition in the form of a video essay presented on a monitor in Ghislain Mollet Viéville’s “apartment” at the MAMCO in Geneva. Excerpts and quotations of video work by artists of different generations (among them Douglas Gordon, Dan Graham, Pierre Huyghe, Jonas Mekas, Philippe Parreno, Wolfgang Staehle, Barbara Visser and John Williams) are brought to bear on material from various sources, mainly from the sphere of infotainment (reality TV as it might be called today, in the broad sense: documentaries, movies, etc.). |
| Format |
Video essay |
| Date |
9 June – 12 September 2004 |
| Location |
Apartment of Ghislain Mollet-Viéville, MAMCO, Geneva |
| With |
Excerpts from: With contributions by (in order of appearance in the video essay): |
Related archive
Interview with Julien Blanpied
Entretien avec Julien Blanpied
par Lore Gablier
22.08.2018
Lore Gablier : Pourrais-tu commencer par te présenter : quel est ton parcours et comment as-tu rencontré l’École ? Qu’est-ce qui t’a décidé à postuler ?
Julien Blanpied : J’ai fait partie de la Session 13, en 2003-2004. Mon parcours s’est construit et précisé lentement, année après année. Au lycée, j’ai suivi une spécialisation en « Histoire des arts » que le lycée Poincaré à Nancy proposait. Les cours, les enseignants, la dynamique de la classe étaient vraiment enthousiasmant. J’ai continué à Nancy avec une Maîtrise en Histoire de l’art, où la frustration d’arrêter les cours aux années 1970 était telle que j’ai voulu en savoir plus sur « la suite ».
C’est là où ça s’est précisé : l’art et son langage m’intéressaient, mais ma curiosité m’a amené à l’art contemporain. Une fois que j’ai eu ma Maîtrise, je suis entré en 4e année à l’École du Louvre : l’année spéciale dite “de muséologie”. À l’École du Louvre, tu fais un peu ton emploi du temps comme tu veux en choisissant des options et une période d’étude. Et j’ai choisi la période « art contemporain ». Mon mémoire avait pour sujet « Un choix de typologies d’interventions d’artistes contemporains dans l’exposition de collections publiques permanentes de musées ». Ce qui m’intéressait c’était de savoir qui faisait l’accrochage dans un musée. Qui parlait ? Qui énonçait un propos ? À qui s’adressait-on ? Et si ce n’est pas un commissaire, qui ça peut être ? Et si c’est un artiste, qu’est-ce que ça raconte ? J’avais choisi plusieurs cas particuliers dont celui de Jean-Hubert Martin qui était le directeur général du Kunstpalast à Düsseldorf à l’époque. Pour le Musée des Charmes, il avait demandé à un sculpteur et à un peintre allemand (Thomas Huber et Bogomir Ecker) de concevoir avec lui l’accrochage. À l’époque j’avais trouvé hyper intéressant qu’il y ait un échange à plusieurs voix – tu vois là le lien qu’il peut y avoir avec l’École ensuite… de travailler sur un accrochage à plusieurs, avec des spécificités différentes. Je m’intéressais aussi à ce projet car il était transhistorique : c’est-à-dire que Jean-Hubert Martin voulait vraiment qu’il y ait un mélange des périodes, et qu’il y ait comme des rapprochements formels et conceptuels à travers le temps. Je crois que dans ce mémoire à l’École du Louvre il y avait un peu tout c’est-à-dire que je me suis dit que l’art contemporain ça m’intéressait, mais ce qui m’intéressait aussi particulièrement c’était la conception de l’exposition.
Il faut se remettre aussi à l’époque : à l’université il n’y avait pas de cursus dédié à l’exposition ou alors, ça débutait tout juste. Il y avait l’École du Magasin en France, De Appel en Hollande, le Goldsmith College en Angleterre, des programmes aux USA, mais c’était des circuits disons alternatifs dans une scolarité. Ça m’intéressait assez de jouer un rôle entre l’artiste, l’œuvre, le public. Et donc à l’époque, je me suis concentré sur le métier de commissaire d’exposition et la conception de l’exposition. L’École du Louvre était assez formatée (et très précise) et quelqu’un m’a parlé de formations qui existaient, dédiées à la pratique de l’exposition. Un truc « professionnalisant ». A l’École du Magasin, on ne délivrait pas de diplômes. Il y avait un projet qu’on portait, qu’on réalisait et après tu partais à la recherche d’un boulot, avec ton projet sous le bras. C’est le sous-titre de la formation : formation professionnelle aux pratiques curatoriales.
LG : Parle-moi de ta session.
JB : On était une petite session : on était six – cinq français et une bulgare qui parlait parfaitement français, du coup c’était aussi notre langue de travail. Il y avait Clément Nouet qui sortait d’un cursus « beaux-arts » à Montpellier ; Albane qui sortait de sociologie ; on était deux « historiens d’art » (Guillaume et moi) ; il y avait Thierry qui avait déjà bossé dans une galerie commerciale allemande ; et il y avait Katia qui vivait en Italie et qui avait déjà une activité de commissaire indépendante. Elle était un peu plus âgée que nous. On avait tous entre 24-26 ans sinon, je crois. Aujourd’hui, je crois savoir que tout le monde bosse dans le « milieu ». (Thierry a fait plein de boulots, pour le printemps de Septembre, avec Jean-Marc Bustamante, et est Responsable de programmation artistique, chargé de mission auprès du directeur des Beaux-Arts de Paris ; Guillaume est directeur, responsable artistique de Documents d’artistes ; Katia poursuit son parcours de curatrice indépendante ; Albane a fait plein de boulots, à Immanence par exemple, et est diplômée d’une école d’architecture à Londres ; Clément travaille au MRAC de Sérignan, comme Chargé de l’organisation des expositions.)
Ce qui m’a attiré à l’École c’était les études alternatives. Il y avait quelque chose à bâtir : il n’y avait pas de prof. J’avais aussi besoin d’une approche alternative de l’histoire (de l’art), et l’École du Magasin m’intéressait beaucoup pour ça. Il y avait aussi « l’expérience du pragmatisme » : on était dans le faire. Et c’est ce qui m’a le plus intéressé dans l’École. Me confronter au réel.
LG : Et donc tu débarques à Grenoble : comment ça se passe ?
JB : J’ai beaucoup aimé la ville. Je quittais Paris sans douleur…. J’avais aussi un oncle qui vivait là-bas qui m’a aidé à m’installer.
Ensuite, la vie de groupe s’est construite assez facilement. On était tous de la même génération. Je me souviens que certains d’entre nous sont venus s’installer en couple. Et c’était assez cool cette époque. On se voyait assez souvent. On passait aussi beaucoup de temps à l’École. On pensait que c’était important qu’on soit présent à Grenoble et d’être dans l’échange. On a aussi beaucoup voyagé. Mais on aimait bien se rencontrer à l’École. C’était important pour moi parce qu’en même temps que l’École, je faisais de la musique – et j’en fais toujours d’ailleurs (fr.wikipedia.org/wiki/P.O.box). Ça me prenait énormément de temps à l’époque. C’est un groupe qu’on n’a jamais voulu professionnel mais qui était organisé comme tel : on a enregistré des albums et fait énormément de concerts partout en Europe, au Japon, en Russie, au Canada. On a un van, un label, une agence de booking, etc. Et c’était très prenant. Trois week-ends sur quatre je n’étais pas à Grenoble et du coup il y a des choses que je n’ai pas vécues avec le groupe de Grenoble à cause de ça. Il y avait une bonne ambiance de groupe. Je ne me souviens pas m’être brouillé avec quelqu’un : c’était très respectueux.
LG : Et vous aviez des relations avec la scène artistique grenobloise ? À quoi ressemblait-elle à l’époque ?
JB : Alice Vergara nous a dit qu’elle avait un regret car au départ de l’École, il y avait beaucoup de relations avec l’école des beaux-arts de Grenoble. Peut-être que ça ne nous serait pas venu à l’esprit spontanément, mais du coup on a rencontré des gens de l’École des beaux-arts. J’étais copain avec Clôde Coulpier et Quentin Armand. J’ai rencontré de chouettes personnes à l’École des beaux-arts. On se voyait de temps en temps mais c’était quand même plutôt en dehors du travail. On n’a pas directement travaillé avec eux, en tout cas au début de l’année. On a par contre assisté à beaucoup de conférences. Il y avait eu Ian Baxter, Christophe Domino qui sont venus. On avait rencontré Ludovic Burel, qui était professeur, ainsi que Bernard Joisten. On avait aussi rencontré un collectionneur, Bruno Henri : sa maison était incroyable ! Je remets toujours ça dans le contexte. J’avais 23-24 ans et je n’avais jamais vraiment travaillé sauf en tant que conférencier à Musée des Beaux-Arts de Nancy. Et c’était fascinant de rencontrer toutes ces personnes qui étaient des acteurs professionnels. C’est ce que je te disais tout à l’heure : il y avait un côté pragmatique et l’expérience à l’École m’a beaucoup plu et enrichi. On a aussi rencontré des étudiants des beaux-arts de Lyon car on considérait que pour notre projet ce serait bien de ne pas travailler qu’avec des artistes étrangers ou connus. Il y avait Marie Voignier à Lyon, par exemple.
La quatrième année de l’École d’art a fait son exposition au Magasin, vers mars, avril ou mai. On était en train de monter notre projet au MAMCO mais on les a aussi aidés à monter leur exposition.
LG : Au Magasin ? Il y avait une exposition des diplômés au Magasin ?
JBv: Oui, c’est incroyable… Et on a donc aidé sur le montage, pas du tout sur la conception. Et pour continuer sur nos liens avec la scène locale, on a aussi invité Georges Rey et Joël Bartoloméo à nous parler de leur travail. Et Joël a contribué à notre projet de fin d’année. Je me souviens qu’on avait aussi rencontré tous les services du centre d’art, toujours dans cet objectif de comprendre comment ça fonctionne. Il y a toujours une comptabilité à faire même si tu détestes les maths et les fichiers excel. Il y a toujours un communiqué de presse à faire même si tu détestes communiquer et simplifier des concepts que tu as essayé de nuancer pendant un an. C’était assez enrichissant.
LG : Parle-moi de vos voyages.
JB : Il y en a eu une dizaine. On est allé à la FIAC, à la Biennale de Venise, à Manifesta qui se déroulait à San Sébastian. Nous sommes souvent allés à Genève, on a rencontré Andrea Fraser, des galeristes et Christian Bernard du MAMCO. On a fait des foires, on est allé à Dijon rencontrer Didier Marcel, Éric Troncy, les gens du Consortium…, l’appartement galerie « Hors d’œuvres » ; et puis notre tuteur, Vincent Pécoil, était de la région. Mais on a aussi conclu l’année aux Férias de Nîmes, que Clément voulait nous faire vivre.
LG : Comment se passent les premiers mois ? Comment développez-votre projet et quelle est votre méthodologie ?
JB : Il y avait une équipe pédagogique constituée de Liliane Schneiter et Catherine Quéloz. Alice Vergara était la Coordinatrice de l’École du Magasin. Elle nous a expliqué qu’on n’allait pas trop la voir mais qu’elle saurait tout. Je sais qu’il y a eu parfois des conflits avec elle, mais pour ma part, j’ai apprécié, à mon âge, d’avoir une personne comme celle-là. Quant à la méthodologie, en gros, on a réparti l’année en trois tiers. Le premier tiers était vraiment dédié à la théorie : l’histoire et la critique des expositions, les expositions critiques – ça c’était pour Catherine. Liliane faisait beaucoup de trucs un peu alternatifs : les logiciels experts, les communautés, les interfaces, les art zones… Elle était vraiment dans un délire qui à l’époque n’était pas du tout évident. En fond, il y avait tout ce qui découlait de la théorie critique de l’École de Francfort (l’industrie culturelle, et des pratiques activistes). Aujourd’hui tous ces concepts sont peut-être évidents, mais à l’époque ce n’était pas le cas. On était encore au début d’Internet. On avait une boîte mail, mais ça ne faisait pas plus de 3-4 ans. Donc Catherine et Liliane ont fait ce premier tiers d’année. On a organisé des tables rondes avec Lionel Bovier. Lorsqu’il est venu la première fois, il nous a indiqué qu’on allait discuter de méthodes curatoriales, de pratiques artistiques et des indépendances relatives des commissaires d’exposition. Il nous a alors demandé comment nous souhaitions procéder. Est-ce qu’on voulait discuter ? Est-ce qu’on se voyait dans une salle ou à l’extérieur ? Comment on allait « échanger ». Et on a donc proposer d’organiser des tables rondes. On se gardait beaucoup de tout ce qui pouvait être un peu autoritaire. On aimait les chemins disons alternatifs. Et il a accepté cette forme de l’échange. Donc le premier tiers de l’année a été très théorique.
Et on a vu tout au long de ce premier « trimestre » Vincent Pécoil. Je pense qu’il avait déjà des idées. Il avait envie de nous faire bosser sur l’idée de freak show. Il nous avait montré le film de Tod Browning. Il nous a fait lire du J-G Ballard. Mais le sujet en lui-même, on voulait se l’approprier. On a demandé à Vincent pourquoi il amenait un sujet, et pour lui, il s’agissait d’éviter de tergiverser. C’était un sujet très large et modulable, qui pouvait évoquer plein de choses. Je ne me souviens plus si c’était un sujet de débat ou pas, mais pour nous c’était important de s’approprier ce sujet de réflexion. Et du freak show on a été amené à réfléchir sur le comment du pourquoi une exposition peut différer d’un spectacle ou d’une forme d’entertainment. L’historique du freak show était l’occasion aussi pour nous de retracer les espaces d’expositions comme les expositions universelles qui étaient en fait les prémisses d’un monde de l’entertainment.
Pour nous à l’époque, cette société du loisir, du spectacle, c’était un truc de fou. Depuis un an, il y avait un phénomène qu’en France on ne pouvait pas rater : Loft Story, une émission de télé-réalité. Tout le monde regardait du temps de la première saison, entre fascination et sidération. C’étaient des jeunes gens qui étaient filmé 24h/24, qu’on observait au travers notre écran de télé. Qu’est-ce que c’était que cette exposition ? On a donc retracé toute l’histoire de l’exposition d’êtres humains. On a invité un philosophe, Olivier Razac, qui venait de publier L’Écran et le zoo (2002) et Histoire politique du fil barbelés (2009). Il est devenu un des partenaires de notre projet, et intervient avec sa voix dans notre projet. C’est quelqu’un qui nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses en lien avec l’exposition des corps. Donc le phénomène médiatique qui canalisait toutes les attentions à l’époque c’était la télé-réalité : Qu’est-ce que c’était que cette quête de réel ? Comment pouvait-on analyser les processus de scénarisation du réel (les outils du dispositif télé/zoo) ? Cela touchait aussi énormément à des questions de représentation et de mise en scène de soi. On a donc tordu un peu le projet de départ pour avoir un projet qui a une forme particulière. À l’École, on interrogeait la forme de l’exposition, évidemment. On a donc essayé de trouver une adéquation entre le fond et la forme. Notre projet s’appelait Royal Wedding. C’est un essai vidéo qui dure 35 minutes et se présente sur DVD. C’est un montage qu’on a réalisé à partir de documents divers : œuvres, archives, documents sonores. C’est un travail de citation. La sélection, le découpage, le montage de ce matériel déjà existant nous permet d’effectuer une postproduction discursive, d’expérimenter une forme curatoriale. L’exposition, si tu veux, quand on la regarde, c’est à travers un écran de télévision et on ne voit quasiment aucune œuvre réelle : on ne voit que la représentation ou la diffusion d’œuvres, mais il s’agit toujours d’extraits. Ça a été un peu difficile à faire passer auprès de la direction, mais c’était notre choix. Et ce qui nous intéressait, c’était cette notion de rapport au réel, l’esthétique du quotidien, d’épuisement du réel qui découlait de l’analyse des modèles ou des structures de la télé-réalité (“l’extimité” - l’impératif de l’aveu – le stade vidéo).
On a réfléchi à ces différents phénomènes de société. Je crois que ça nous tenait à cœur d’avoir une exposition qui parle de notre génération et de notre époque. On a donc essayé de faire un essai vidéo sur les rapports au réel dans les pratiques artistiques contemporaines. On a monté des extraits d’infotainment, d’entertainment, de séries télé et des œuvres d’art. On les a articulés les uns aux autres, sans volonté de démonstration, et les regardeurs, « téléspectateurs » faisaient eux-mêmes les rapprochements formels et logiques. Ils réalisaient leur propre montage.
D’un point de vue formel, il y avait une émission qui était diffusée sur Arte qui nous a beaucoup inspiré : elle s’appelait Die Nacht [La Nuit] réalisée par Paul Ouazan et Claire Doutriaux. Elle était diffusée à minuit, et je me souviens l’avoir regardée avec d’autres collègues du Magasin. C’était une émission étrange : diffusée tard la nuit, elle enchaînait des vidéos d’artistes sans aucune explication. Il y avait aussi une autre référence formelle qui était pour nous déterminante : Rock My Religion (1983-84) de Dan Graham.
LG : Parle-moi des œuvres que vous avez choisies.
JB : Pour te donner un aperçu du contenu : il y avait par exemple des images d’une vidéo qui s’appelle Another World Earthday in Biosphere 2, qui est un projet de reconstitution de biosphère sur terre, et dans lequel des scientifiques ont fait vivre six ou dix personnes pendant un an, je crois, dans cet univers clos reconstitué. Les gens étaient filmés : c’était une sorte de Loft Story, sauf que c’était en 1991 et pour le bien scientifique. C’est sur ces images que l’essai vidéo commence. Ça enchaîne ensuite avec un extrait du générique de Loft Story qui consiste en un travelling dans les coulisses du dispositif. Là, il y a tous les dispositifs qui se mettent en place : le confessionnal, la mission, l’extimité…
On a aussi introduit un extrait d’un film complètement dingue qui s’appelle What A Flash!, réalisé par Jean-Michel Barjol en 1972. Sur le plus grand plateau de cinéma de l’époque qui se trouvait dans le nord de Paris, ils ont invité 200 personnes du monde du spectacle, peintres, musiciens, acteurs ou techniciens autour d’un même scenario loufoque : « En l’an 2000, des hommes et des femmes refusent le bonheur anesthésiant que leur propose le pouvoir en place. Celui-ci les enferme dans une fusée pour un vol spatial au terme duquel la mort les attend. Ces condamnés à mort défient une dernière fois le régime en faisant du temps qui leur reste une grande fête. »
Tout est filmé comme dans Love Story. C’est complètement fascinant. On a aussi choisi les premières séries télé fondées sur le modèle et les stéréotypes de la famille “américaine”. Il y avait aussi un extrait d’une série de l’époque qui s’appelait 24h, et qui était constitué de 24 épisodes d’une durée d’une heure : tout se déroulait soit disant en temps réel. Il y avait une scène du tournage de Matrix, un extrait du film de Brian de Palma, Snake Eyes, et de Confessions intimes. Tout ça est mis en relation avec des œuvres dont Les Enfants gâtés de l’art de George Rey ; notamment filmé à l’occasion des Ateliers du Paradis à la galerie Air de Paris à Nice, où Pierre Joseph, Philippe Parreno et Philippe Perrin ont passé un mois à ne faire « pas grand-chose ». Je trouve intéressant de mettre en relation Loft Story et les Ateliers du paradis : ça n’a rien à voir sauf que la forme est quasi-identique. Ce que ça raconte est totalement différent voire antithétique, mais la forme est la même. Ça me fascine quand les choses se ressemblent et qu’elles disent exactement le contraire. Pour moi, c’est un des regards de l’art. En tout cas, ça parle d’un quotient schizophrénique des choses qu’il faut toujours intégrer et prendre en compte. On a aussi montré des œuvres de Dan Graham, des vidéos de Joël Bartoloméo. Il y avait aussi Kolkoz (Benjamin Moreau et Samuel Boutruche), ce groupe d’artistes qui avait réalisé un simulateur de vie de type « Shoot them all » où ils invitaient des gens à rentrer dans des appartements de collectionneurs et à buter tous les gens qu’ils croisaient. Et il y avait des œuvres d’art qui étaient représentées dans le simulateur. Ça, ça date de 2002. Il y avait aussi des portraits de Rineke Dikjstra. Il y avait Les Gens de Calais de Sylvie Blocher, il y avait Jonas Mekas qui enregistraient des scènes de vie avec son petit microphone. On passe des moments où l’écran est noir et on entend simplement des extraits de Jonas Mekas. Il y avait forcément 24h Psycho de Douglas Gordon. Et aussi d’autres artistes moins reconnus : Liisa Lounila, Michael Wesely, John Smith, Marc Geffriaud et Julien Crépieux. Il y avait dans notre essai vidéo des extraits de The Third Memory de Pierre Huyghe (qui est une de mes pièces préférées). Et Barbara Visser qui jouait son propre rôle dans une série lituanienne (dans la série, il y a une exposition de Barbara Visser qui était invitée à participer à la série). Et ça finit par Shoot de Chris Burden. Là on expérimentait la réalité : c’est-à-dire, qu’est-ce que c’est que de se faire tirer dessus ? Qu’est-ce que ça veut dire « facing the dragon » quand on voit des gars se faire tirer dessus toute la journée à la télé ? Et puis à l’époque où Burden réalise cette pièce, on est en pleine guerre au Vietnam.
LG : Vous avez présenté cet essai vidéo dans l’appartement de Ghislain Mollet-Viéville reconstitué au MAMCO de Genève, n’est-ce pas ?
JB : Exactement. Mais avant d’entrer dans les détails, j’aimerais parler du titre que nous avons choisi : Royal Wedding. Je pense qu’il s’est imposé à nous après qu’un d’entre nous nous ait raconté cette histoire : le fait que la première retransmission en mondovision à la télé c’était le couronnement royal d’Elisabeth II en 1953. On a donc regardé les images. Il y avait plein de commentaires dans les journaux anglais qu’on a lus qui disaient que ceux qui avaient assisté au couronnement l’avaient trouvé fastueux, alors que la retransmission médiatique était très décevante. Du coup, il y avait une claire distinction entre ceux qui avaient assisté au couronnement, et ceux qui l’avaient suivi avec ce filtre médiatique. Il s’avère qu’au tout début des années 1980, Lady Di et Charles se marient. C’est un mariage princier où le réel a été commandé par la fiction. Ils savaient qu’il y aurait une retransmission télévisuelle, et ils ont donc organisé la cérémonie en fonction de sa représentation médiatique. La diffusion télévisuelle s’intitula « Royal Wedding ». Pour nous, c’était exactement ce renversement qu’on voulait toucher du doigt : la représentation médiatique devenait plus intéressante que le réel. Il y avait là quelque chose qui trébuchait devant nous, et c’est de là qu’on a eu l’idée du titre Royal Wedding. S’est posé ensuite la question d’où diffuser cette exposition. Il ne s’agissait pas d’une exposition physique. La question de l’immatériel, qui aujourd’hui est un poncif, n’était pas du tout évidente à l’époque. L’exposition était d’une certaine manière immatérielle : elle était sur un DVD. Et comme le Magasin cette année-là était fermé pour rénovation, on a sollicité le MAMCO, un alter-lieu. Liliane, Catherine travaillait à la HEAD de Genève, et Lionel Bovier avait aussi des liens via les éditions JRP Ringier avec la Suisse. Au MAMCO, l’appartement de Ghislain Mollet-Viéville a été reconstitué à l’identique. Toutes les œuvres qui sont dedans sont réelles. Il y avait des Buren comme on dit, des « vrais » Carl Andre, Art & Language, Robert Barry, Walter de Maria, Peter Downsbrough, Dan Flavin, Donald Judd, On Kawara, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Lawrence Weiner… Il y a le salon, la cuisine, la chambre. Et on a trouvé ça pertinent car il y avait du faux dans le vrai et vice-versa, et c’est un peu ce qu’on raconte dans notre essai vidéo. On a donc proposé d’installer un téléviseur dans le salon, en face du canapé. Je ne me souviens plus si Christian Bernard trouvait ça cool ou non, mais on l’a fait. On était assez content. Et lorsqu’on a montré notre exposition, on a aussi rencontré Andrea Fraser. C’était hyper intéressant son regard sur l’essai vidéo.
LG : Selon toi, comment était promue la figure du curateur à l’École à l’époque ?
JB : Je crois qu’il y avait cet idéal du commissaire indépendant. On a beaucoup parlé d’Harald Szeemann. On a rencontré Hans-Ulrich Obrist, Éric Troncy : beaucoup de commissaires qui incarnaient le métier. L’image était donc plutôt celle d’un commissariat indépendant mais qui n’en reste pas à la conceptualisation d’une exposition. Je crois me souvenir qu’on essayait de réfléchir plutôt aux cinq phénomènes de société qui nous interrogeaient, plutôt que de réfléchir à nos cinq expositions préférées pour construire les expositions. Il y a plein d’autres choses : par exemple, il s’agit parfois d’aller chercher de l’argent (le commissaire fundraiser) ; à d’autres moments, il s’agit de la relation à l’artiste. Je ne pense pas qu’on parlait du commissaire artiste ou auteur. À l’époque, c’était une image qui me plaisait mais ce n’était pas celle qui était promue par l’École. On abordait souvent la question de la recherche, de l’archivage (ça me rappelle qu’Alice nous avait demandé de réfléchir à ce qu’on pourrait faire avec les centaines de cartons d’invitation que l’École recevait. Je ne suis pas sûr qu’on ait donné suite. Mais il y avait vraiment cette problématique de l’archivage, du papier).
LG : Et comment l’École t’a-t-elle influencé professionnellement et personnellement ?
JB : Ces notions d’indépendance, d’autonomie et d’activisme, qui étaient très présentes à l’École, ont conforté mon positionnement. La question de l’activisme avait un écho particulier pour moi du fait de ma pratique de musicien, où la question du do-it-yourself est nodale. Je joue dans un groupe où on est six personnes. Et on était également six à l’École. Pour moi, la manière de distribuer la parole, que quelqu’un décide d’organiser la prise de parole et que ça soit tournant : à 23-24 ans, je n’avais pas du tout ces notions. Ça s’est mis en place parce qu’on était six et que tout le monde avait envie de parler mais ce n’était pas possible : il fallait qu’on s’organise. Il y avait beaucoup de parallèles avec la musique. Enregistrer un album et le sortir via un label et un réseau de communication, c’est faire une exposition. Organiser des tournées, contacter des gens, remplir des contrats : structurellement, ce sont des pratiques très semblables à celles de l’exposition. Je pense que l’École, à part cette question de l’activisme, mettait également l’accent sur la question de l’autonomie : même si on n’est pas autonome, il est important de savoir à qui on doit quoi. D’où l’on parle. Et il y avait enfin la question de l’indépendance, qui est une autre version de l’autonomie. Ces trois notions sont pour moi celles qui se sont enrichies le plus à l’École.
Il y a aussi une relation à l’artiste que j’ai aujourd’hui et qui à mon avis n’est pas étrangère à l’approche qu’on avait à l’École, où il fallait toujours argumenter les choses. La manière de construire un projet avec un artiste en l’accompagnant et en trouvant la bonne distance avec lui, le projet et l’institution : c’est ce que j’essaie de faire et que je dois en partie à l’École.
Entretien avec Thierry Leviez
Entretien avec Thierry Leviez
par Damien Airault
24.06.2018
Damien Airault : Où es-tu né et en quelle année ?
Thierry Leviez : Je suis né en 1979 à Paris, mais c’est un hasard : ma famille vient du nord et j’ai grandi à Toulouse.
DA : Quelles études avais-tu fait avant d’entrer à l’École du Magasin ?
TL : J’ai un parcours un peu biscornu. Au lycée j’avais un profil de « bon élève » et j’ai atterri sans conviction dans une prépa puis, à l’issue de concours, en École de commerce à Rouen.
J’avais l’idée de travailler dans la culture, mais c’est une idée qui se résumait alors pour moi à l’idée de devenir vendeur à la FNAC, ce que j’ai fait assez longuement. En fait pendant le plus gros de mon parcours en École de commerce j’étais libraire à la FNAC. On te demande de passer beaucoup de temps en entreprise et en stage, c’était pratique.
J’ai fait un échange universitaire de 6 mois à l’Université d’économie d’Hanovre et ensuite je suis parti à Berlin travailler dans des galeries. J’ai travaillé comme stagiaire chez Carlier/Gebauer et dans une petite galerie. Et travailler dans ces galeries m’a donné envie de devenir commissaire d’exposition.
J’ai vu sur internet qu’il y avait une école à Grenoble et j’ai bien préparé mon dossier que j’ai envoyé comme une bouteille à la mer en me disant « ils ne me prendront jamais parce que je n’ai absolument pas le parcours ». J’étais le premier à passer à l’oral, je crois que ça intriguait l’équipe de l’École du Magasin de voir quelqu’un qui venait d’une école de commerce. J’ai été reçu immédiatement. Ils m’ont tout de suite dit « On a vraiment envie que tu viennes à l’École du Magasin ». Pour moi c’était génial parce que j’étais perdu…
C’était le point de départ d’un vrai projet d’orientation professionnelle et par la suite j’ai obtenu un Master 2 à l’Ecole du Louvre en suivant un parcours en VAE.
DA : Tu te souviens du projet que tu as rédigé pour rentrer ?
TL : Il fallait faire une exposition sur le papier et mon projet était très naïf. Ça s’appelait La peau sociale avec des artistes comme Rineke Dijkstra. J’avais un intérêt sincère et profond pour l’art mais une méconnaissance totale de ce monde en dehors du fait je commençais à connaître assez bien la scène allemande.
(…)
Je me souviens très bien du jour où j’ai eu une sorte d’épiphanie quand quelqu’un m’a décrit le rôle d’un commissaire. J’ai fait une recherche sur Google et je suis tombé sur l’École du Magasin.
DA : Est-ce que tu te souviens de qui était dans le jury ?
TL : Il y avait Alice [Vergara-Bastiand], je crois qu’il y avait Liliane [Schneiter]ou Catherine [Quéloz]… Je ne me souviens plus.
DA : Donc en octobre 2003 tu déménages à Grenoble ?
TL : Oui, c’était difficile parce que j’avais un petit budget et que Grenoble était cher. J’ai trouvé une chambre de bonne d’environ 10 m2 avec les toilettes sur le palier, mais qui était bien parce qu’elle était au-dessus d’un McDonald, à l’époque mon principal fournisseur.
DA : Vous êtes combien d’élèves ?
TL : On était 6. Il y avait avec moi Katia Anguelova, Albane Duvillier, Guillaume Mansart, Clément Nouet et Julien Blanpied.
DA : La coordinatrice était Alice Vergara ? Est-ce que vous aviez un tuteur ?
TL : Oui, c’était Vincent Pécoil. Il nous a beaucoup suivi sur le projet qu’on a ensuite présenté au MAMCO. C’est lui qui a donné la première impulsion : à 6 c’est un peu difficile d’arriver à trouver un sujet commun. Nous nous entendions bien, nous étions assez amis et nous le sommes toujours. Et c’était vraiment très agréable.
(…)
Vincent a créé une amorce et il a laissé les choses évoluer dans une direction qui n’était peut être pas celle qu’il avait envisagée initialement. À l’époque c’était un jeune commissaire et aussi un jeune auteur, il avait publié déjà plusieurs livres, dont Prières américaines je crois. Il n’était pas beaucoup plus vieux que nous. Il travaillait, si je ne me trompe pas, sur une exposition sur les freak shows qu’il a réalisée quelques années plus tard à la Monnaie de Paris. Il travaillait sur la présentation d’objets anormaux dans le monde de l’art, des objets qui échappaient à la norme comme les prétendus monstres des freak shows. De là il y a eu un glissement vers toutes les productions liées à la télé-réalité qui était un peu nouvelles à ce moment-là et commençaient à devenir un phénomène culturel massif au début des années 2000. Nous avons glissé du concept de freak show, l’exposition de personnes vivantes dans des foires, à l’exposition de la réalité dans les médias et notamment à la télévision. Tout ça a donné le point de départ du projet. On était vraiment au moment du Loft. L’idée d’un usage brut du réel, repris dans l’art et dans les productions des artistes.
DA : Tu te souviens de comment vous passiez vos journées ? Comment était votre emploi du temps ? Est-ce que tout le monde était là tout le temps ?
TL : On était assez présents parce qu’on était plusieurs à venir de loin et tout le monde vivait à Grenoble. On a fait aussi beaucoup de voyages.
On est allés au Casino du Luxembourg. On est allés à Genève, surtout pour les cours avec Catherine et Liliane. C’est surtout nous qui allions à Genève, à la HEAD, plutôt qu’elles qui venaient à Grenoble. Et on allait aussi à Genève pour le MAMCO, car notre projet était montré dans « l’appartement » de Ghislain Mollet-Viéville. On est venus à Paris plusieurs fois, par exemple ici aux Beaux-Arts de Paris où il y avait une exposition de Marianne Lanavère qui s’appelait Densité ± 0. On est allés en Belgique, à Dijon, à Bâle…
DA : Qui est-ce que vous rencontriez ?
TL : Le souvenir que j’ai c’est que c’était très facile d’être reçus. Quand nous annoncions, à un musée par exemple, que nous étions une promotion du Magasin, nous étions reçus en général par le directeur ou des personnes haut placées. Les portes s’ouvraient très facilement.
On a dû voir Enrico Lunghi au Casino du Luxembourg. On voyait Christian Bernard régulièrement. À Dijon on a vu Éric Troncy qui nous avait harangués en disant qu’on n’était pas assez révolutionnaires…
Dans l’École Vincent Pécoil était très impliqué, il venait très régulièrement, une semaine par mois. C’était très enrichissant et très agréable de travailler avec lui. Lionel Bovier est venu plusieurs fois. Quelques artistes comme Adel Abdessemed qui n’était pas très connu à l’époque. (…)
Quelque chose qui était très formateur aussi c’est qu’on a travaillé sur le montage d’une exposition d’Olaf Breuning. Il était sympa et très accessible. Il y avait une sorte de procession de fantômes qui arpentaient la « rue » du Magasin et qui avait été entièrement produite par l’École. On avait fabriqué des sortes de porte-manteaux en bois, fait des têtes avec des ballons, etc. Il tenait à ce côté « bricolé » et on était de bons clients pour fabriquer une centaine de fantômes avec les moyens du bord.
DA : De quoi traitaient les cours de Catherine et Liliane ?
TL : Je me souviens de conseils de lecture, de cours sur l’École de Francfort, sur les façons dont peuvent converger la communication politique et la communication d’une exposition. C’était des questions fondamentales d’art et de politique relatives au commissariat, plus que des enseignements techniques.
DA : Qui est allé négocier au MAMCO ? C’était votre idée ?
TL : Ce n’était pas très compliqué pour le MAMCO parce que notre travail était un « essai vidéo ». A l’arrivée l’essai vidéo demandait toutes les conditions de production d’une exposition, le transport en moins, mais toutes les demandes de prêts, les négociations avec les artistes, les galeristes, etc., étaient là. D’autant qu’on avait dû faire des coupes dans certaines pièces pour les faire rentrer dans l’essai.
Il y avait aussi des extraits de documentaires, quelques extraits du Loft et des pièces d’artistes. Donc on a dû négocier avec chaque artiste. On avait tout fait, écrit le texte, fait le montage… Il y avait une voix off avec une narration et la progression de l’argumentaire.
On montrait les Ateliers du Paradise [de Pierre Joseph, Philippe Parreno et Philippe Perrin]. C’était la démonstration que l’art, dans une certaine mesure, avait anticipé les effets de réel du divertissement. Et que l’art était rentré en concurrence avec ces formes de divertissement, avait eu à les dépasser ou en tout cas à s’en accommoder.
En même temps on avait vraiment produit une exposition, je me souviens d’appeler des artistes, des galeristes comme je le fais aujourd’hui, négocier des droits, discuter du bien-fondé de leur inclusion dans notre projet.
A la fin c’était un DVD et la diffusion au MAMCO se résumait à une télévision placée dans le salon de Mollet-Viéville, comme dans un espace domestique. Le projet a été inauguré en même temps qu’un cycle d’expositions du MAMCO et il faisait partie de la liste des expositions de ce cycle. Pour nous c’était une visibilité importante.
DA : Et vous comme élèves vous vous sentiez comme dans un Loft, les caméras en moins ?
TL : Oui je pense que ça a dû participer à notre réflexion, une mise en abîme de notre propre situation.
DA : Vous vous êtes répartis les artistes, vous aviez chacun des artistes en charge ?
TL : Oui, parce que chacun avait apporté sa pierre à l’édifice. Et ensuite nous nous sommes organisés avec des sortes de sous-thématiques. (…) Je me souviens qu’il y avait dans notre essai Barbara Visser qui avait réussi à infiltrer une série télévisée et y jouait son propre rôle d’artiste. (…) Sur le contenu du projet on était relativement libres et assez autonomes, ce qui nous a fait faire aussi quelques erreurs de débutants.
DA : Qu’est-ce que tu fais après l’École du Magasin ?
TL : J’ai travaillé à la production du Printemps de septembre à Toulouse où je suis devenu commissaire par la suite.
DA : Comment tu voyais le commissariat indépendant à l’époque ?
TL : Je n’avais pas une vision fine du métier. Mais on avait tous un peu des modèles différents. Par exemple je me souviens avoir été convaincu par Caroline Bourgeois qui nous avait reçus avec Régis Durand au CNP [Centre Nationale de la Photographie] au moment où elle montait la rétrospective Valie Export. Elle nous avait tenu un discours très humble sur le rôle du commissaire, comme soutien aux artistes.
A l’époque il y avait une querelle entre Éric Troncy et tous ses pourfendeurs comme Éric Mangion qui avait publié un pamphlet assez violent contre lui. Le débat se polarisait à partir de ces positions. Certains étudiants étaient du côté de Troncy, le commissaire auteur et je défendais une position plus proche de Mangion ou Bourgeois les commissaires au service des artistes. Les choses sont devenues infiniment plus complexes depuis me semble-t-il…