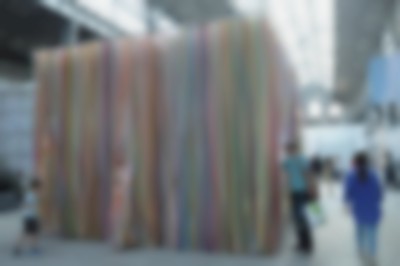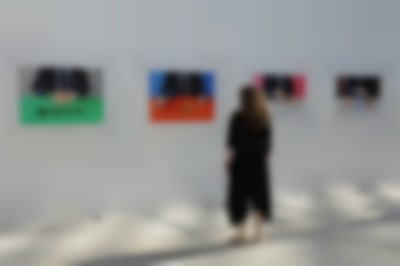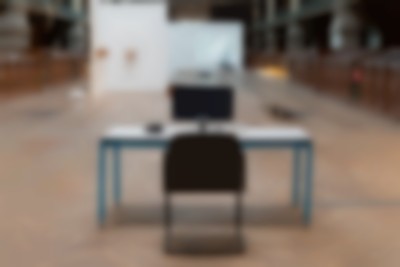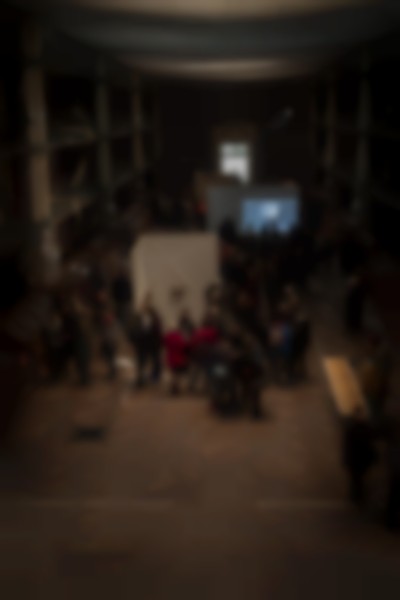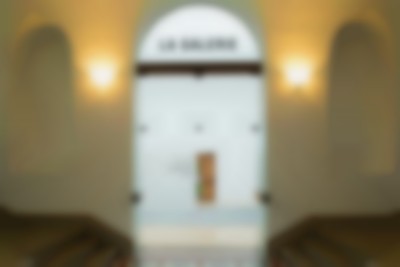Session 25: présentation
| Session | 25 (2015–2016) |
|---|---|
| Participant·es |
Chen Ben Chetrit |
| Direction | – |
| Site de la session | – |
| Coordination |
Anaëlle Pirat-Taluy |
| Tutorat |
Manuel Segade |
| Équipe pédagogique |
Katia Schneller & Dean Inkster (projet Craig Owens) |
| Personnes rencontrées |
AAA Association (Grenoble) |
| Voyages |
Amsterdam-Rotterdam (11–14 fev. 2016) |
Archives liées
Briser La Glace
| Projet |
Briser La Glace |
|---|---|
| Présentation |
Armance Rougiron, Chen Ben Chetrit, Chloé Curci, Eleonora Castagna, Giulia Pagnetti et Laura Caraballo ont collectivement élaboré le projet Briser la glace en réagissant au contexte spécifique du centre d’art, le MAGASIN. |
| Format |
Exposition |
| Date |
29 mai – 4 septembre 2016 |
| Lieu |
Le Magasin-CNAC |
| Avec |
Ricardo Basbaum Invités du programme public: |
Archives liées
Documents
- Poster A3 [pdf, 141,56 KB]
- Press release (EN) [pdf, 1 003,45 KB]
- Communiqué de presse (FR) [pdf, 1 003,9 KB]
- Agenda programme publique [pdf, 57,5 KB]
- Revue de presse [pdf, 2,45 MB]
Médias et liens
Photographies
Il faut qu'il se passe quelque chose
| Projet |
Il faut qu'il se passe quelque chose |
|---|---|
| Présentation |
Il faut qu’il se passe quelque chose est le titre choisi pour l’Exposition de Noël, présentée par quatre des participantes de la Session 25 : Laura Caraballo, Eleonora Castagna, Chloé Curci et Giulia Pagnetti. L’Exposition de Noël est un rendez-vous annuel qui permet un aperçu de la production artistique diverse et hétérogène liée à la région Rhône-Alpes. |
| Format |
Exposition |
| Date |
6 décembre 2015 – 3 janvier 2016 |
| Lieu |
Ancien musée de peinture de Grenoble |
| Avec |
Alexis Bérar |
Archives liées
Documents
- Texte dossier de presse (FR) [pdf, 31,17 KB]
- Feuille de salle [pdf, 87,08 KB]
- Dossier d’inscription - Exposition de Noël (FR) [pdf, 106,08 KB]
Photographies
-

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vue d’exposition -

[2015]
Vue d’exposition -

[déc. 2015]
Vernissage -

[déc. 2015]
Vernissage
Toute première fois
| Projet |
Toute première fois |
|---|---|
| Présentation |
Dans le cadre du partenariat pédagogique entre l’ÉSAD •Grenoble •Valence et l’École du MAGASIN, Chen Ben Chetrit, Georgia René-Worms et Armance Rougiron de la Session 25 ont conçu une exposition à partir de la collection Colette Tornier, de laquelle une série d’œuvres a été sélectionnée. |
| Format |
Exposition |
| Date |
5 – 18 décembre 2015 |
| Lieu |
Galerie de l’École supériere d’art de Grenoble |
| Avec |
Jonathan Binet |
Archives liées
Entretien avec Laura Caraballo
Entretien avec Laura Caraballo
par Damien Airault
18.07.2018
Damien Airault : En quelle année et où es-tu née ?
Laura Caraballo : En 1982, en Argentine.
DA : Tu faisais partie de la Session 25 en 2015-2016.
LC : Oui.
DA : Qu’est-ce que tu avais fait avant d’entrer à l’École du Magasin ?
LC : J’avais fait des études d’Histoire de l’art en Argentine et j’avais toujours été impliquée dans des projets culturels. Ensuite, j’ai décidé de faire une thèse et suis venue en France pour la faire, à Paris Nanterre, en Esthétique.
DA : Tu avais une spécialité en Histoire de l’art ?
LC : Oui, les arts « multiples », spécialement la bande-dessinée et c’est un peu pour cela que je suis venue en France. C’était le lieu le plus intéressant pour moi, avec cette importante tradition de BD et un développement contemporain remarquable.
J’ai fait ça de façon un peu indépendante parce que j’avais une bourse de recherche de mon université en Argentine pour les premières années de thèse.
Le service culturel de l’ambassade française m’a conseillé de faire un Master 2 de recherche pour m’entraîner à l’écriture universitaire en français, qui était vraiment en-dessous de mon niveau de diplôme argentin, l’équivalent d’un BAC+5. J’ai donc fait un Master à l’École Normale Supérieure de Lyon, en Science des arts. C’était dur à tout point de vue, mais je l’ai réussi avec une très bonne note ! L’ENS est un écosystème très particulier que je ne connaissais pas du tout. J’avais lu Pierre Bourdieu avant, qui m’avait donné une idée de la reproduction du privilège dans le système éducatif français, mais c’était en arrivant que j’ai compris que les grandes écoles, ça n’avait rien à voir avec l’université publique, mon univers connu.
Après mon diplôme de l’ENS, ma directrice de recherche, Anne Sauvagnargue, philosophe spécialiste de Gilles Deleuze, a eu son poste de Professeure des Universités à Paris-Nanterre et je l’ai (sans trop me poser la question) suivie. Son approche théorique m’a évidemment influencé et j’ai fait ma thèse en Esthétique et non en Histoire de l’art.
En parallèle j’ai commencé à travailler dans une galerie d’art spécialisée en bande-dessinée, et à voir des planches originales, parfois des véritables œuvres d’art, et ça m’a familiarisé avec le milieu du marché d’originaux de BD. J’étais par ailleurs toujours intéressée par le commissariat d’exposition, en galerie j’ai pu travailler dans la préparation et les montage des exposition.
Je connaissais le Magasin sans trop savoir ce que l’École était, j’avais les informations du site web. Je me suis dit: « Pourquoi pas faire cette formation en parallèle de l’écriture de ma thèse ? » J’avais l’idée comme quoi c’était prestigieux.
DA : C’était prestigieux comment ?
LC : Dans l’imaginaire, les commentaires que j’entendais sur la formation, par exemple le processus de sélection de participants A priori très exigeant… je pense qu’il s’agissait d’un « résidu » des années de gloire du Magasin.
DA : Tu voulais devenir commissaire d’exposition indépendante ?
LC : Oui et non, je voulais travailler dans les expositions et surtout croiser l’art de la BD avec l’exposition : comme objet exposable, dans une définition large. Il y a aussi de plus en plus d’artistes contemporains qui travaillent avec la BD, notamment dans le conceptuel, et des dessinateurs de BD qui font des projets « hors des livres », ainsi que de plus en plus d’expositions.
DA : Tu avais quel âge quand tu as postulé à l’École ?
LC : J’étais la plus vieille de la session, j’ai eu 33 ans au moment de commencer la formation.
DA : Il fallait déposer un projet pour rentrer ?
LC : Non, il fallait déposer un portfolio.
DA : Tu te souviens de ton jury ?
LC : Oui, il y avait Estelle (Nabeyrat) qui était coordinatrice, Manuel Segade qui était le tuteur, Inge Linder-Gaillard de l’École des Beaux-arts et c’est tout je pense. Le directeur, Yves Aupetitallot, était absent.
DA : Ça s’est bien passé ? Tu te souviens des questions qu’ils t’ont posées ?
LC : Oui, ça s’est bien passé, j’étais plutôt à l’aise. Ils m’ont posé des questions sur mon projet, sur ma thèse. J’ai beaucoup parlé de BD. Ils m’ont posé des questions par rapport à l’art contemporain, s’il y avait des artistes qui m’intéressaient particulièrement et des références théoriques. On a aussi eu une partie de la conversation en anglais pour tester la langue.
DA : Tu as déménagé à Grenoble ?
LC : Oui j’ai trouvé un appartement rapidement.
DA : Tu vivais comment pendant cette année ?
LC : En fait j’avais de l’argent mis de côté et comme la vie à Grenoble n’était pas chère (comparée à Paris), j’ai réussi à tenir l’année quasiment sans autres revenus (à part des missions ponctuelles en freelance). Pour moi c’était un projet important et j’ai pris au sérieux ce qu’on m’avait dit lors de l’entretien (Estelle insistait beaucoup là-dessus) : « Il faut venir à Grenoble, vraiment être là et s’investir à 100%. » C’était aussi ma dernière année de thèse, je l’ai soutenue après mon année à l’École.
DA : Combien étiez-vous dans cette année ?
LC : Au départ nous étions sept. Trois diplômées d’écoles d’art françaises : Armance Rougiron, Chloé Curci et Georgia René-Worms, qui est partie à mi-chemin. Il y avait deux italiennes, Eleonora Castagna qui avait déjà fait un Master en commissariat à Milan et et Julia Pagnetti qui avait fait l’École du Louvre. Enfin, une non-européenne comme moi, une architecte israélienne, Chen Ben Chetrit.
DA : Vous discutiez en quelle langue ?
LC : On parlait en anglais, principalement, car Chen ne parlait pas français.
DA : Il y avait Manuel Segade mais qui s’occupait de la coordination ?
LC : Manuel était notre tuteur et Annaëlle Taluy a repris la coordination de la formation, elle avait travaillé auparavant au Magasin.
DA : Elle avait plutôt un rôle administratif, nest-ce pas ?
LC : Oui elle avait un rôle de coordination et elle nous accompagnait parce qu’on était complètement perdues. Nous étions arrivées dans un moment de conflit entre employés et directeur, et suite au départ de ce dernier, on a bien senti le vide institutionnel. On était un peu abandonnées à notre sort.
DA : Et que faisait Manuel Segade ?
LC : Il était notre tuteur, soi-disant, notre guide à l’École. Mais on ne le voyait pas souvent, il venait de Madrid. On a fait quelques séances avec lui au début, on lui présentait nos idées, nos plans de travail. Ensuite il a eu le poste de directeur du CA2M à Madrid et donc il était moins présent. Il a très peu suivi notre travail à la fin, car il était totalement pris par son poste, ce que nous pouvions comprendre.
DA : Est-ce que vous aviez des intervenants réguliers ?
LC : Pas trop, on nous a proposé un séminaire à l’école d’art de Grenoble, et on y est allé deux ou trois fois. Mais en fait on était très prises par les projets. En arrivant au centre d’art, en septembre-octobre, on n’était pas sûres encore de pouvoir commencer l’École du Magasin, parce qu’il y avait beaucoup de problèmes à cause du conflit avec la direction. On a démarré en novembre. Ensuite Estelle est partie. En arrivant on nous a imposé deux expositions de fin d’année, on a dû mettre les mains à la pâte tout de suite !
DA : Est-ce que tu sais comment et pourquoi Estelle est partie ?
LC : Non, on avait l’impression qu’elle était fâchée avec l’administration. Je lui écrivais et l’appelais pour savoir quand l’année allait commencer pour m’organiser, elle n’en savait rien. Finalement on est toutes arrivées au mois de novembre. Elle n’était plus là si je me souviens bien. À ce moment-là, on a appris qu’il y avait une nouvelle coordinatrice, qu’il n’y avait plus de directeur et que le centre d’art n’avait plus de programmation. La dernière exposition en place c’était celle de Didier Faustino avec, à la fin, l’inauguration d’une sculpture dans l’espace public, pas loin du Magasin. Ensuite il n’y a plus eu d’exposition ni d’événement, le vide total.
DA : Vous voyiez des gens de l’École d’art ?
LC : Très peu, selon mon expérience. On a rejoint aussi un workshop donné par Adelita Husni-Bey auquel certaines des filles sont allées. Inge Linder-Gaillard nous a fait une visite de l’École. Mais on n’avait pas trop de contact, en tout cas moi.
DA : Comment vous socialisiez si vous alliez peu à l’École d’art ?
LC : On a fait un minimum de socialisation sur place (à Grenoble). Ma représentation des choses c’est qu’on était isolées, sauf quelques exceptions. J’ai rencontré par exemple Vincent Verlé, qui avait dirigé le centre d’art Bastille à Grenoble et qui connaissait tout le monde sur place et la réalité grenobloise.
DA : Et vous partiez un peu en voyage ?
LC : Oui, ça allait avec les projets, notamment notre projet de l’école. En fait, on nous a d’abord dit qu’on allait faire deux expositions en décembre : l’une était l’exposition de Noël qu’organisait le Magasin et qui résultait d’un appel à projets d’artistes de la région, suite à quoi on sélectionnait les artistes. L’autre, c’était une exposition à partir d’une collection privée qu’on présenterait dans la galerie de l’école d’art.
DA : L’exposition de Noël avait lieu où ?
LC : Elle a eu lieu à l’ancien Musée de peinture. Du coup, on s’est divisées. On était quatre à travailler sur ce projet-là et on a donc participé au jury. On a fait la sélection des œuvres et on a monté l’exposition.
DA : Il y avait d’autres personnes dans le jury ?
LC : Oui, il y avait quelqu’un qui travaillait à l’école d’art de Saint-Étienne, quelqu’un qui travaillait au centre d’art de Genève… Je ne me souviens plus de leurs noms. On a donc participé au jury puis assuré le commissariat. On a fait le display des œuvres sélectionnées dans les salles de l’Ancien musée, c’était une belle expérience.
DA : Vous avez également géré la communication ?
LC : Non, c’était plutôt le Magasin qui s’en occupait. On n’a pas pu trop intervenir. C’est arrivé si vite… Et l’autre groupe a organisé une exposition à l’école d’art avec des œuvres d’une collectionneuse privée de Grenoble. Je ne sais pas trop qui a monté ce projet. Je me rappelle qu’il y avait aussi des collectionneurs locaux dans le jury de l’exposition de Noël car en fait, il y avait un prix qui était le Prix des Collectionneurs de Grenoble, une association. Il y avait aussi un Prix de la Mairie, qui sortait de la sélection qu’on avait faite. Donc on a fait ces deux petits projets en décembre. Le même mois, on nous a proposé de travailler sur l’exposition d’été du Magasin. Le Conseil d’administration était aussi très présent. Je pense que tous ensemble avec l’équipe ils ont décidé de nous proposer de faire l’exposition. C’était une opportunité incroyable pour nous, on a eu carte blanche ! C’était très compliqué institutionnellement : nous étions paumées, seules, « auto-formées » ; mais on avait une liberté énorme pour travailler. C’était une arme à double tranchant.
DA : On vous a donné un budget de combien pour faire cette exposition ?
LC : 80 000 euros.
DA : C’est très peu pour ce genre d’espace.
LC : Oui, c’était très difficile, surtout que c’était à nous de gérer ce budget. Il y avait donc ce projet mais aussi celui de l’École pour lequel on n’avait encore rien fait (en décembre). Notre statut était complètement bâtard. On a travaillé en tant que commissaires invitées alors qu’on était aussi étudiantes à l’École. La communication était aussi une bataille. Notre interlocutrice était Annaëlle, la coordinatrice, et elle était aussi un peu perdue selon ma perception des choses.
DA : Si je pose le cadre, vous ouvrez en juin-juillet deux expositions, dont une au Magasin. Et l’autre elle est où?
LC : L’invitation à faire l’exposition d’été n’avait rien à voir avec le projet de l’École qui n’a pas été une exposition. On a décidé d’utiliser le budget pour faire une « école nomade ». On s’est dit que comme on n’avait pas d’intervenants qui venaient à nous, on irait à eux. C’est comme ça qu’on a commencé à bouger et découvrir des institutions, des chercheurs et des commissaires d’exposition. On a un peu bougé dans la région et on est allées dans le sud de la France et dans le nord de l’Italie, entre autres destinations. Et on a été invitées par la Biennale d’art contemporain à Innsbrück en Autriche. On a visité, fait des rencontres et un workshop.
DA : Donc vous êtes allées voir qui ?
LC : On est d’abord allé à Arles pour assister à un colloque à la Fondation Lima qui s’intitulait « Comment pensent les institutions ? » dont le partenaire principal était une autre école de commissariat : De Appel, à Amsterdam. Là, on a croisé pas mal de gens. Après, on est parties à Marseille. On a rencontré Céline Kopp de Triangle France, ainsi que les artistes qui étaient en résidence : Virgile Fraisse, par exemple. Puis on est parties à la Villa Arson à Nice où on a rencontré les artistes et fait une visite de l’école avec une médiatrice. De là, on est allées en Italie, à Milan et Turin. On a rencontré les commissaires de la Fondation Pirelli, on a visité le Castello di Rivoli avec une guide, par exemple. On a tout documenté, nous avions l’intention d’en faire une publication, mais c’était trop ambitieux, vu le peu temps qu’on avait.
DA : À Innsbrück, qui s’occupait de vous ?
LC : C’était une personne bénévole de la Biennale. Elle nous a fait visiter tous les lieux d’art contemporain. Nous n’avons pas trouvé ça passionnant, c’était une initiative privée.
DA : Et donc tout ça c’était votre « École nomade ». Et donc, vous vous considériez comme des élèves ou comme des profs ?
LC : Comme des élèves qui « s’auto-formaient ».
DA : Vous êtes allées rencontrer vos tuteurs, en quelque sorte.
LC :Exactement. Il y a eu aussi un voyage en Hollande où je ne suis pas allée. Moi, je suis partie seule à Barcelone et j’ai fait l’École nomade de mon côté.
DA : Elles sont allées où en Hollande ?
LC : À Amsterdam, où elles ont rencontré beaucoup d’acteurs de la scène contemporaine. Moi, je ne pouvais pas y aller car j’avais prévu d’être à Barcelone. Je connaissais beaucoup d’artistes là-bas, et j’ai aussi rencontré l’équipe du BAR Project (avec notamment deux anciennes de l’école1 ) que j’ai interviewées, et c’était aussi une contribution pour l’École nomade.
DA : Et Manuel a complètement disparu ?
LC : Il n’était pas très présent. On l’a rencontré deux fois, on a échangé avec lui quelques fois par visio et il est venu au vernissage de l’expo d’été. Mais il a laissé son empreinte, on l’a toutes beaucoup apprécié et même admiré comme personne et comme professionnel. D’ailleurs nous sommes allées le voir à Madrid à la fin de l’année, on a tellement rigolé tous ensemble ! Je l’ai vu plusieurs fois au cours des dernières années, c’est un type brillant.
DA : Et comment ça se passait ce projet d’auto-formation dans votre groupe ?
LC : Voyager à sept, ce n’est jamais facile. Mais c’était bien car chacune faisait des propositions et il y avait beaucoup d’enthousiasme. Par exemple, Georgia a proposé Nice, Chloé a organisé Marseille. Et les italiennes ont fait les démarches pour l’Italie. C’était assez complexe car on a dû tout monter toutes seules et ça nous a pris beaucoup de temps pour le mettre en place. On a fait un gros travail de gestion budget, épuisant. Et puis on faisait des interviews, photos, vidéos… On documentait tout pour avoir de la matière pour cette publication que nous n’avions jamais pu faire.
DA : Et vous voyiez l’équipe du Magasin ? Il y avait encore du monde qui travaillait ?
LC : Oui. Il n’y avait pas beaucoup de gens mais on les voyait beaucoup car en marge de l’École nomade on a commencé à travailler sur le projet d’exposition pour le Magasin, là on avait affaire à tous les services.
DA:; Et pour ça vous avez travaillé en collaboration avec l’équipe.
LC : Oui, c’était ça qui était bien. On a appris tout le fonctionnement du centre d’art un peu par la force ! On avait une liberté de création, nous avons préparé une présentation pour le Conseil d’administration, pour leur soumettre nos idées et avoir l’accord de tout le monde. Au départ on a voulu travailler avec des artistes sur des projets d’expositions solo mais ce n’était pas évident vu les délais. On voulait absolument travailler avec Céline Condorelli qu’on avait rencontrée à Arles, parce qu’elle travaille avec l’espace, mais ça ne s’est pas fait. On voyait cet espace immense de « La Rue » du Magasin vide, énorme verrière, et du coup on voulait l’intervenir. On a chacune fait énormément de propositions d’artistes avec qui on voulait travailler et on a monté une expo collective. Au total, on a travaillé avec 10-12 artistes et œuvres si je me souviens bien. Tout le processus a été documenté.
DA : Comment s’appelait l’exposition ?
LC : Briser la glace. La problématique de départ c’était le constat, une fois qu’on est arrivées à Grenoble et commencé à parler avec les locaux, que personne ne connaissait le Magasin. J’avais parlé avec une copine qui vivait là depuis des années et elle ne savait pas ce que c’était. On disait toujours que c’était le lieu à côté de la Belle Électrique, une nouvelle salle de concert à l’époque, alors que le centre d’art était là depuis plus de trente ans !
DA : Vous avez appelé l’exposition Briser la glace alors que le gros squat qui était au-dessus avant s’appelait le Brise-glace.
LC : Oui, on a joué un peu avec ça… On a fait des recherches sur l’histoire du lieu, cela nous intéressait toutes. Et l’Exposition de Noël sur laquelle on a travaillé s’appelait Il faut qu’il se passe quelque chose. En fait, on voyait qu’il n’y avait rien qui se passait et ça dépendait quelque part de nous à ce moment là. Donc pour l’exposition d’été, notre idée a été de faire une exposition très ouverte, accessible et gratuite : on s’est battues pour la gratuité et on l’a mise dans le budget, on a payé les entrées, pour que les gens viennent et reviennent. On voulait inviter tout le monde à habiter l’espace. On a cherché à convertir l’espace de La Rue en espace public. On a donc monté des échafaudages, pour rester dans l’idée de construction. On a fait appel à une entreprise d’échafaudages et on a monté les œuvres dessus, c’était énorme. L’expertise de Chen, l’architecte, a été là-dessus, centrale. Et on a aussi décidé de ne travailler qu’avec l’espace de La Rue, ce qui était assez compliqué. Il faisait très chaud et il y avait beaucoup de soleil.
DA : Donc vous avez fermé les espaces des galeries ?
LC : Oui. Et la manière dont a choisi les artistes n’a pas toujours été simple. On faisait toutes des propositions et on a aussi emprunté des œuvres au Musée de Grenoble. Il y avait Allen Ruppersberg, Candice Breitz, Pipilotti Rist… Il y avait des artistes confirmés et d’autres émergents. J’avais personnellement proposé d’inviter un artiste argentin de BD conceptuelle, Martín Vitaliti ; Chen, un formidable artiste israélien, Leor Grady, et ainsi de suite. Chacune a apporté quelque chose à l’exposition côté artistes. Il y avait des œuvres existantes et une autre partie, des créations pour le lieu, notamment Matteo Guidi, avec qui on a fait aussi des ateliers lors du programme public. On est beaucoup intervenues en matière d’accrochage ce qui nous a été reproché. On était, limite, invasives dans notre proposition curatoriale… L’idée principale était d’inviter le public à intervenir, à participer. On a aussi invité Emmanuel Louisgrand, à l’initiative de Julia, à réaliser une œuvre verte qui a été présentée à l’extérieur et qui évoluait tout au long de l’été. À tout ça s’ajoutait un programme public tout l’été.
DA : Quelles étaient les activités ?
LC : Principalement des conférences, des performances et workshops… Ah, j’oubliais un pan important de l’exposition. En fait il y a un accès aux galeries au fond de la “Rue” : on a fermé une partie et construit un mur pour créer une sorte d’amphithéâtre arrondi qui devienne un lieu pour le programme public, là-dedans on a organisé plusieurs conférences, c’était extraordinaire.
DA : Qui avez-vous invité ?
LC : Des artistes et des commissaires, principalement. Par exemple, Benjamin Efrati est venu faire une drôle de performance, Irene Campolmi une conférence. Nous avions invité Cecilia Bengolea et Jeremy Deller pour une danse-performance pour le finissage, mais Béatrice Josse, à son arrivé à la tête du Magasin, a arrêté l’exposition à l’avance et annulé le finissage. C’est vrai que les conditions n’étaient pas bonnes pour les œuvres (sous la verrière, l’été), mais nous avons trouvé sa façon de procéder violente, elle n’a jamais voulu communiquer avec nous directement… On avait aussi commencé à travailler avec des associations locales mais pas autant qu’on aurait voulu : c’était trop ambitieux pour quatre mois.
DA : Comment vous répartissiez-vous le travail ?
LC : Nous avons toutes participé à la conception de l’exposition et puis il y a eu une répartition de tâches qui s’est faite un peu naturellement en fonction des sensibilités de chacune. Chen et Armance travaillaient sur la scénographie et le montage, côte à côte avec techniciens et monteurs. Chloé s’occupait de tout ce qui touchait à la communication et au graphisme. Avec Eleanora, on était chargées du travail théorique et du programme public. Avant la fin de l’année, Giulia a eu la chance d’être embauchée dans un poste qui lui correspondait complètement, au Cairn à Digne-les-Bains, donc elle a travaillé à distance en fin de parcours.
Avec la date d’ouverture de l’exposition qui approchait, on s’est de plus en plus concentrée chacune sur sa tâche. Les filles qui travaillaient sur le display étaient tout le temps avec les monteurs. Le reste on travaillait en étroite collaboration avec les services de la communication et des publics.
DA : Du coup c’était plus plutôt très bien tout ça !
LC : Oui, c’était une expérience incroyable. On a pu travailler sur tous les aspects d’une exposition, on a énormément appris et on a eu un plaisir fou à voir l’exposition réalisée ! Et le travail collectif, j’ai énormément apprécié ça.
DA : Georgia était furieuse. Qu’est-ce qui s’est passé ?
LC : Je pense que Georgia a eu du mal à s’intégrer au reste du groupe et nous, on a eu du mal à l’intégrer elle. J’avais l’impression qu’elle savait travailler en équipe, mais avec des personnes imposées qu’elle ne connaissait pas, c’était une toute autre histoire… En même temps c’étaient les règles du jeu à l’École. Je sentais qu’elle était un peu sur la défensive à ce moment-là, mais en fait, la grande problématique pour nous c’était qu’on avait une charge de travail énorme alors qu’on ne se connaissait pas du tout. En plus de nos différents bagages culturels, professionnels et disciplinaires ! On avait des discussions parfois tendues, mais on a finalement réussi à trouver un équilibre. Car pendant les voyages à sept, c’était difficile. Georgia était aussi très prise par d’autres projets et elle partait souvent, ce qu’on lui reprochait. Son départ définitif a permis de décompresser et tout a mieux roulé après pour le travail. Par contre on a été blessées par le manque d’explication de sa part, elle a quitté sans prévenir en laissant une lettre à la coordinatrice de l’École, mais elle ne l’avait pas autorisé à nous la montrer. Anaëlle n’a rien voulu nous expliquer… C’était vraiment dommage.
DA : Et du coup, dans cette année, à aucun moment vous n’avez eu de cours théoriques ou d’histoire de l’art.
LC : Non, il y avait un séminaire autour de Craig Owens à l’école d’art mais en fait, on n’avait pas beaucoup de temps. Personnellement, je n’avais pas vraiment besoin de théorie. J’en avais déjà tellement fait, avec une thèse en cours, j’avais soif de concret.
DA : Et les autres, elles s’y sont retrouvées dans cette expérience très pratique ?
LC : Oui, les filles avaient déjà de l’expérience, et les plus intellectuelles, Eleonora et moi, nous y avons trouvé notre compte aussi.
DA : Quand toi tu es arrivée à l’École, tu voulais devenir commissaire d’exposition indépendante mais ça a changé. Qu’est-ce qui s’est passé ? Tu t’es rendu compte que c’était dur ?
LC : Oui, mais je le savais déjà. Je me souviens avoir eu une discussion avec Georgia qui disait qu’elle ne voudrait jamais être liée à une institution, elle voulait rester libre, c’était une conviction. Et ça m’a fait réfléchir et me dire que j’aime bien l’engagement qu’implique le fait d’être lié à l’institution. En plus, le côté indépendant reste très précarisant en France, vu le statut particulier des commissaires.
DA : Et la scène des commissaires indépendants en France, vous la connaissiez ? Vous en parliez ?
LC : Peu… En fait, on a surtout fréquenté des institutions. On a pu échanger avec certains commissaires mais il y en a vraiment peu qui puissent en faire une activité à temps plein et avec la rémunération qui va avec.
DA : Comment ça se passe à la sortie ? Qu’est-ce que tu fais ?
LC : C’était un moment de ma vie un peu compliqué. Je n’avais pas prévu de revenir à Paris, où je vivais depuis quelques années, mais d’aller à Barcelone. Au début c’était une adaptation difficile. Mais j’ai fini par rencontrer plein de gens dans la scène de l’art contemporain, très riche dans cette ville. Il y a un centre d’art qui est aussi une bibliothèque municipale spécialisée BD à Hospitalet de Llobregat, dans la banlieue. C’est un ancien quartier industriel en plein développement où il y a des galeries et des ateliers d’artiste. Là, j’ai rencontré des personnes et commencé à monter des projets mais c’était impossible car il n’y avait aucun financement. Presque un an après, j’ai décidé de revenir en France. Il faut dire qu’en France, comparé à l’Espagne ou l’Argentine, il y a plus de possibilités financières pour les projets cultuels.
DA : Qu’est-ce que tu penses de l’idée du projet de faire l’histoire de l’École du Magasin ?
LC : Pour moi, c’est très important. En fait, quand on est arrivées à l’École, on ne savait pas qu’on serait la dernière session, mais on savait que quelque chose était en train de s’écrouler. On le voyait autour de nous.
J’ai parlé avec mes camarades Eleonora et Chen, et elles voulaient ne mentionner que ce qu’il y a eu de positif, notamment toute cette liberté qu’on a eue et cette belle expérience partagée. Et c’est vrai qu’on a une représentation de l’École du Magasin très positive car, malgré tout, elle nous a permis de faire un gros projet et nous éclater. Maintenant qu’elle n’existe plus, il est important de faire vivre cette mémoire et la valeur que cette formation a eu dans un certain contexte de l’art contemporain en France.
Je vous remercie pour ça.
- BAR Project a été co-fondé par Veronica Valentini (Session 19) et Andrea Rodrigez Novoa (Session 20) ↩